

PROTÉGER
LES ANIMAUX, LES PERSONNES ET LA PLANÈTE
Rejoignez un groupe de vétérinaires qui utilisent les technologies les plus avancées pour offrir d'excellents soins à leurs patients, agissant en même temps comme une force positive pour les communautés locales et mondiales.
Sécurité à 100 %. Nous ne partageons jamais vos informations.

Articles récents

13 effets à long terme de la chirurgie TPLO chez le chien
Découvrez les effets à long terme de la chirurgie TPLO : mobilité, arthrose, implants, poids, rééducation et qualité de vie des chiens opérés.
L’ostéotomie de nivellement du plateau tibial (TPLO) est une chirurgie courante pour traiter une rupture du ligament croisé crânien (LCC) chez le chien. Ce ligament stabilise le genou et, lorsqu’il est endommagé, il provoque douleur, boiterie et arthrose.
La chirurgie TPLO est très efficace pour restaurer la mobilité, mais de nombreux propriétaires se demandent quels sont ses effets à long terme. Comprendre ce qui peut arriver des années après l’opération aide à mieux accompagner son chien et à prendre de bonnes décisions de santé.
Dans cet article, nous examinons les principaux effets à long terme de la TPLO, en détaillant les bénéfices, les risques et les défis à anticiper.
1. Mobilité améliorée et meilleure qualité de vie
La plupart des chiens retrouvent une mobilité quasi normale après la récupération. Ils reprennent leurs activités habituelles et restent actifs pendant des années. Cette amélioration durable est l’un des plus grands avantages de la TPLO.
2. Risque d’arthrose dans l’articulation opérée
Même si la TPLO ralentit l’arthrose, elle n’élimine pas totalement le risque. Avec le temps, certains chiens développent une raideur et une gêne. Un poids adapté, des compléments articulaires et l’exercice doux (comme la natation) sont essentiels pour limiter l’arthrose.
3. Risque de rupture du ligament de l’autre patte
Jusqu’à 50 % des chiens opérés d’une patte développent plus tard une rupture du LCC sur l’autre patte. Cela s’explique par la surcharge pendant la récupération. Une bonne musculation et le maintien du poids limitent ce risque.
4. Cicatrices et raideur à long terme
La formation de tissu cicatriciel est normale après la chirurgie. Chez certains chiens, cela peut causer une légère raideur, surtout en hiver. Des exercices doux et des massages aident à garder la souplesse.
5. Complications liées aux implants
La plaque et les vis posées restent en place toute la vie. Dans de rares cas, elles peuvent provoquer irritation, infection ou relâchement. Un suivi vétérinaire est nécessaire si boiterie, gonflement ou rougeur apparaissent.
6. Gestion du poids plus difficile
Certains chiens prennent du poids après l’opération à cause de la baisse d’activité. Or, le surpoids fragilise les articulations. Un régime équilibré et des promenades contrôlées sont essentiels.
7. Changements dans la biomécanique du genou
La TPLO modifie l’angle du plateau tibial, ce qui change la façon de marcher. En général, les chiens s’adaptent bien, mais toute modification de la démarche doit être surveillée par un vétérinaire.
8. Influence de l’âge
Les jeunes chiens récupèrent plus vite et présentent moins de complications. Les chiens âgés mettent plus de temps à guérir et sont plus sujets à l’arthrose. Des soins personnalisés (examens, compléments, physiothérapie) améliorent leurs résultats.
9. Risques d’infection et inflammation chronique
Les infections sont rares mais possibles autour de l’implant. Des solutions modernes comme Simini Protect Lavage réduisent fortement ce risque. Rougeur, chaleur et boiterie doivent alerter et nécessitent un contrôle vétérinaire rapide.
10. Besoin de rééducation régulière
La réussite à long terme dépend de la rééducation. Hydrothérapie, physiothérapie et exercices supervisés aident à renforcer les muscles et à maintenir la mobilité.
11. Importance de la nutrition pour les articulations
Un apport en glucosamine, chondroïtine et oméga-3 aide à protéger les articulations. Un régime équilibré avec protéines de qualité favorise aussi la masse musculaire et la récupération.
12. Changements comportementaux et anxiété
La convalescence peut provoquer frustration et anxiété. Des jeux interactifs, des jouets à friandises et du temps de qualité avec le maître aident à réduire le stress.
13. Facteurs génétiques
Les grandes races (Labrador, Golden, Rottweiler) sont plus prédisposées aux problèmes articulaires. La prévention passe par le contrôle du poids, les compléments et des exercices doux et réguliers.
Conclusion
La chirurgie TPLO apporte de grands bénéfices à long terme : mobilité, confort et qualité de vie. Mais elle comporte aussi des défis, comme l’arthrose, les risques d’implants ou la raideur articulaire.
Avec une bonne gestion du poids, des exercices adaptés et un suivi vétérinaire régulier, la majorité des chiens opérés vivent heureux et actifs pendant de longues années.

Récupération post-opératoire après une chirurgie TPLO chez le chien
Guide complet sur la récupération post-opératoire TPLO chez le chien. Conseils vétérinaires pour soins, exercices, escaliers, sauts et guérison.
Si votre chien a récemment subi une chirurgie TPLO (ostéotomie de nivellement du plateau tibial), vous avez déjà franchi une étape importante pour l’aider à se rétablir d’une rupture du ligament croisé crânien (LCC). Cette blessure fréquente provoque de la douleur et rend la marche difficile, mais la chirurgie TPLO stabilise l’articulation du genou et améliore la mobilité.
Maintenant que l’opération est terminée, votre rôle dans la récupération est essentiel. Des soins post-opératoires adaptés assurent une bonne cicatrisation de la zone chirurgicale et aident à prévenir les complications comme les infections ou une nouvelle blessure. Durant les prochaines semaines, votre chien comptera sur vous pour une activité contrôlée, un environnement propre et sûr, ainsi qu’une bonne gestion de la douleur. Les exercices de rééducation associés au repos permettront de retrouver force et confiance.
La convalescence peut sembler difficile, mais avec de la patience et les bons conseils, votre chien pourra retrouver une vie active et sans douleur. Ce guide vous accompagne à travers les étapes clés des soins post-opératoires afin d’assurer une guérison optimale.
À quoi s’attendre pour la patte de votre chien après une chirurgie TPLO
Après une chirurgie TPLO, la patte de votre chien subira plusieurs changements normaux liés au processus de guérison, tels que la raideur, l’enflure et une récupération progressive des muscles.
Changements courants après l’opération
- Raideur et mobilité limitée : La raideur est fréquente au cours des premières semaines à cause de l’enflure et de la cicatrisation. Votre chien peut hésiter à poser sa patte ou montrer de l’inconfort en marchant.
- Atrophie musculaire : Le manque d’utilisation de la patte peut entraîner une perte de muscle, surtout au niveau de la cuisse et du mollet. Cela peut sembler inquiétant mais s’améliore avec la rééducation.
- Formation de tissu cicatriciel : Une petite crête ferme près de l’incision est un phénomène normal qui s’atténue avec la guérison complète.
Le rôle de la physiothérapie
La physiothérapie est essentielle pour reconstruire la force, réduire la raideur et retrouver la mobilité. Les exercices de mobilisation passive, réalisés selon les conseils du vétérinaire, préviennent le blocage de l’articulation en début de récupération. Par la suite, les promenades en laisse contrôlée et les exercices doux comme la natation aident à renforcer les muscles et à améliorer la souplesse.
Un vétérinaire ou un spécialiste en rééducation canine peut proposer un plan personnalisé adapté aux besoins de votre chien. Ces séances favorisent la confiance, l’équilibre et la mobilité tout en réduisant le risque d’effort excessif.
Étapes clés de la récupération
- Semaines 1–4 : Repos et mouvements limités. L’enflure et la raideur diminuent peu à peu, et le chien commence à poser légèrement la patte.
- Semaines 4–8 : Début des exercices supervisés et de la physiothérapie pour renforcer les muscles et améliorer la marche.
- Semaines 8–12 : Augmentation progressive des promenades pour retrouver la fonction complète. La plupart des chiens récupèrent une grande partie de leur mobilité à cette étape.
- 3–6 mois : La récupération complète est généralement atteinte, bien que le délai varie selon l’animal. Les examens de suivi et les radiographies confirment la progression.
Gestion de l’enflure après une chirurgie TPLO
L’enflure est un phénomène naturel de la guérison, mais elle doit être surveillée et contrôlée pour éviter l’inconfort ou les complications.
Pourquoi l’enflure apparaît
Elle survient lorsque le corps envoie du sang, des nutriments et des cellules immunitaires sur le site chirurgical pour réparer les tissus. Cela provoque rougeur, chaleur et gonflement autour de l’incision. Une légère inflammation est normale, mais un gonflement excessif ou persistant peut indiquer une infection ou une surcharge articulaire.
Conseils pour réduire l’enflure
- Application de froid : Utilisez une poche de glace enveloppée dans un tissu doux, pendant 10 à 15 minutes toutes les 4 à 6 heures durant les 48–72 premières heures. Ne placez jamais la glace directement sur la peau.
- Repos et activité limitée : Restreignez les mouvements pour éviter tout effort. Utilisez une cage ou un espace confiné pour empêcher les sauts ou les courses.
- Médicaments : Le vétérinaire peut prescrire des anti-inflammatoires ou des antalgiques. Suivez strictement ses recommandations et n’utilisez jamais de médicaments humains sans autorisation.
- Surélévation de la patte : Quand le chien est couché, placez la patte opérée sur un coussin pour limiter l’accumulation de liquide.
Signes d’alerte nécessitant une visite vétérinaire
Consultez rapidement si vous observez :
- Une aggravation du gonflement après 3–4 jours.
- Une rougeur intense, chaleur excessive ou écoulement au niveau de l’incision.
- Des signes de douleur sévère, fièvre ou refus de bouger.
- Une ouverture de la plaie ou une apparence infectée.
Quand mon chien peut-il monter les escaliers après une chirurgie TPLO ?
En général, un chien peut recommencer à monter les escaliers 6 à 8 semaines après l’opération, uniquement avec l’accord du vétérinaire et sous surveillance. Une tentative trop précoce peut fatiguer l’articulation et retarder la guérison.
Pourquoi les escaliers sont risqués
Monter oblige le chien à supporter son poids sur la patte en guérison, tandis que descendre ajoute une forte contrainte sur le genou à cause de l’impact. Ces mouvements peuvent nuire à la cicatrisation ou endommager les implants.
Calendrier de reprise
- Semaines 1–6 : Escaliers interdits. Portez les petits chiens et bloquez l’accès avec des barrières.
- Semaines 6–8 : Accès limité, avec surveillance. Commencez par une ou deux marches avec laisse et harnais.
- Semaines 8–12 : Reprise progressive possible si le vétérinaire l’autorise. Surveillez étroitement les progrès.
Conseils pour aider votre chien
- Utilisez une laisse ou un harnais pour contrôler ses mouvements.
- Installez une rampe si vous avez plusieurs étages.
- Bloquez l’accès aux escaliers hors supervision.
- Laissez-le avancer à son rythme sans le forcer.
Quand mon chien peut-il sauter sur le canapé après une chirurgie TPLO ?
En général, le saut sur le canapé n’est autorisé qu’à partir de 12 semaines ou plus après l’opération, et seulement avec l’accord du vétérinaire. Sauter exerce une forte pression sur le genou et peut entraîner une rupture de l’implant ou une nouvelle blessure.
Phases de guérison
- Début (0–6 semaines) : Les os et tissus sont encore fragiles. Limitez les promenades à la laisse.
- Milieu (6–12 semaines) : La consolidation osseuse progresse, mais les activités à fort impact comme le saut restent interdites.
- Long terme (12+ semaines) : Si la guérison est satisfaisante, les sauts peuvent être réintroduits très progressivement sous validation vétérinaire.
Conseils pour éviter les sauts
- Bloquez l’accès avec des barrières ou housses de canapé.
- Offrez des alternatives sûres comme une rampe ou des marches pour animaux.
- Utilisez la cage ou un parc pour restreindre les mouvements.
- Enseignez des ordres simples comme « reste » ou « descends » pour limiter les tentatives de saut.
Conclusion
La récupération après une chirurgie TPLO demande patience, engagement et attention aux détails. Votre rôle est crucial pour assurer une bonne cicatrisation et éviter les complications. Des soins adaptés comme garder l’incision propre, limiter l’activité et administrer les médicaments prescrits favorisent un rétablissement harmonieux. Les visites de suivi permettent de vérifier les progrès et d’agir rapidement en cas de problème.
Les exercices de rééducation validés par le vétérinaire sont indispensables pour renforcer la patte et améliorer la mobilité. En respectant le plan de soins et en surveillant les signes de progression ou de complications, vous aiderez votre chien à retrouver une vie active et sans douleur.
La guérison peut prendre plusieurs semaines ou mois, mais chaque étape rapproche votre compagnon de la récupération complète. Votre dévouement et votre amour font toute la différence dans son parcours de guérison.
Tous les articles

Préparer la chirurgie TPLO de votre chien
Découvrez des conseils simples et pratiques pour préparer votre chien à une chirurgie TPLO : examens préopératoires, aménagement de la maison et organisation de la convalescence
Planifier un examen vétérinaire et des tests préopératoires
Avant une chirurgie TPLO, votre chien doit bénéficier d’un examen complet afin de s’assurer qu’il est assez fort pour supporter l’anesthésie et la récupération. Cet examen permet de détecter des problèmes cachés (cardiaques, infectieux…) pouvant augmenter les risques.
Le vétérinaire recommandera aussi des analyses sanguines préopératoires : une numération formule sanguine (NFS) et un profil biochimique pour vérifier l’absence d’anémie, de troubles hépatiques ou rénaux, et de signes d’infection. Ces tests confirment que les organes fonctionnent correctement et peuvent tolérer l’anesthésie.
Dans certains cas, d’autres examens comme une analyse d’urine ou une radiographie thoracique sont nécessaires, surtout chez les chiens âgés ou malades chroniques. Un bilan complet réduit les risques et augmente les chances de succès chirurgical.
Adapter le mode de vie avant la chirurgie
Les semaines précédant l’opération, il est important de limiter l’activité physique. Évitez les courses, sauts ou longues promenades afin de ne pas aggraver l’instabilité du genou. Trop d’efforts compliquent la réparation chirurgicale.
Il est aussi essentiel de contrôler le poids : l’excès pondéral surcharge l’articulation et augmente les risques opératoires. Privilégiez une alimentation équilibrée, limitez les friandises et respectez les portions recommandées par le vétérinaire. Un chien plus léger et calme se remettra mieux.
Préparer un espace de convalescence confortable
Avant le retour à la maison, aménagez une zone calme et sécurisée pour la récupération. Une cage ou une petite pièce est idéale, avec une literie douce, une bonne aération, et éloignée des escaliers et sols glissants.
Disposez la gamelle d’eau, la nourriture et les médicaments à portée. Retirez les meubles ou objets sur lesquels il pourrait sauter. Cet environnement doit réduire le stress et les risques de nouvelles blessures.
Sécuriser la maison
Après une TPLO, les déplacements de votre chien seront instables. Installez des tapis antidérapants sur les sols lisses (carrelage, parquet) pour éviter les glissades. Bloquez l’accès aux escaliers avec des barrières ou portes fermées.
Éliminez les obstacles comme jouets, câbles ou encombrements dans les couloirs. Une maison sécurisée aide votre chien à se déplacer sans risque supplémentaire.
Les fournitures indispensables pour la récupération
Prévoir le bon matériel facilite grandement la convalescence :
- Harnais de soutien avec poignée pour aider aux promenades courtes.
- Collerette élisabéthaine pour empêcher le léchage de la plaie et éviter les infections.
- Jouets interactifs et puzzles alimentaires pour occuper son esprit tout en maintenant le repos physique.
La veille de la chirurgie
Respectez scrupuleusement les consignes alimentaires du vétérinaire. En général, le chien doit être à jeun 8 à 12 h avant l’opération, mais l’eau reste autorisée jusqu’à quelques heures avant (selon les indications précises de la clinique).
Préparez les médicaments postopératoires (antidouleurs, antibiotiques) afin de les avoir disponibles immédiatement au retour. Assurez-vous que l’espace de repos est prêt et vérifiez l’heure exacte du rendez-vous pour un départ serein.
Planifier les soins postopératoires
Une bonne organisation améliore la guérison :
- Planifiez les visites de contrôle pour surveiller la cicatrisation, la stabilité de l’implant et l’évolution de la douleur.
- Respectez les prescriptions médicamenteuses : antidouleurs et antibiotiques doivent être donnés aux bons horaires pour éviter douleur et infection.
- Restreignez strictement l’activité : pas de course, saut ni escaliers durant plusieurs semaines. Promenades uniquement en laisse courte, et confinement à l’intérieur pour protéger le genou opéré.
FAQ
Quand mon chien pourra-t-il remarcher après une TPLO ?
La plupart peuvent faire de courtes sorties hygiéniques en laisse dans les 24–48 h. Mais aucun effort ou jeu n’est permis durant les premières semaines.
Peut-il dormir sans collerette ?
Seulement s’il ne peut pas atteindre la plaie. Dans la majorité des cas, la collerette doit rester en place jour et nuit pendant 10 à 14 jours.
Quand dois-je appeler le vétérinaire après la chirurgie ?
Contactez-le si vous observez un gonflement, un écoulement, une odeur, une perte d’appétit, des vomissements ou une boiterie aggravée.
Combien de temps dure une récupération complète ?
La majorité récupère en 8 à 12 semaines. La consolidation osseuse et le retour aux activités normales prennent souvent jusqu’à 4 mois, avec suivi et reprise progressive.

Avant et après la chirurgie TPLO : santé du chien et calendrier de récupération
Guide complet avant et après la TPLO chez le chien. Étapes, soins post-op, complications et calendrier de récupération pour un retour à la mobilité
Une rupture du ligament croisé crânien (LCC) peut faire boiter un chien, lui provoquer de la douleur et gêner ses mouvements. La chirurgie TPLO (ostéotomie de nivellement du plateau tibial) est l’une des meilleures méthodes pour restaurer la mobilité et limiter les dommages articulaires à long terme. Cette intervention stabilise le genou, en particulier chez les chiens actifs ou de grande taille.
Beaucoup de propriétaires se demandent si leur chien va marcher normalement à nouveau, combien de temps prendra la récupération et quels progrès attendre. La bonne nouvelle est que la plupart des chiens retrouvent une fonction normale en quelques mois et reprennent leurs activités sans douleur.
La TPLO reste une chirurgie majeure qui demande une préparation avant l’opération et des soins attentifs après. Ce guide explique pas à pas ce qu’il faut savoir avant, pendant et après l’opération pour aider à prendre de bonnes décisions pour la santé de votre chien.
État du chien avant et après la chirurgie TPLO
Connaître l’état attendu avant et après l’opération aide à mieux soigner et à fixer des attentes réalistes. Voici un résumé simple du processus.
Avant la chirurgie
Avant l’opération, le chien boitera probablement ou évitera d’appuyer sur la patte blessée. On peut voir un gonflement au niveau du genou, des difficultés pour se lever ou se coucher et une réticence générale à bouger. Avec le temps, le muscle de la patte affectée s’amincit, rendant les mouvements plus difficiles. Sans traitement, l’instabilité articulaire conduit souvent à l’arthrose et aggrave la douleur.
Immédiatement après la chirurgie
Juste après la TPLO, le chien sera somnolent à cause de l’anesthésie et aura besoin de repos. La patte opérée sera enflée et raide. Les mouvements seront très limités. Des analgésiques et des anti-inflammatoires seront donnés pour gérer la douleur. Le chien aura besoin d’aide pour aller aux toilettes et devra rester dans un espace calme et confiné pour éviter toute blessure.
2 semaines après l’opération
Vers la deuxième semaine, le chien peut commencer à poser un peu de poids sur la patte opérée. L’incision devrait être en voie de cicatrisation, mais un léger gonflement peut persister. Des courtes promenades en laisse, toujours contrôlées, aident la récupération. Il faut proscrire la course, les sauts et les jeux violents. Garder le chien calme est essentiel pour une bonne guérison.
6 à 8 semaines après l’opération
C’est la période de progrès notable. La force et la stabilité s’améliorent. Une radiographie de contrôle vérifiera la bonne consolidation osseuse. Les exercices de rééducation et les mouvements contrôlés aident à reconstruire la masse musculaire. L’activité non contrôlée reste interdite.
3 à 6 mois après l’opération
À ce stade, la plupart des chiens retrouvent une fonction complète. Ils peuvent courir, jouer et reprendre leurs activités normales sans douleur. La musculation continue et la gestion du poids restent importantes pour prévenir de nouvelles blessures. Si les deux genoux ont été opérés, la récupération peut être un peu plus longue, mais le résultat à long terme est très bon.
État préopératoire du chien
Avant la TPLO, les chiens présentent souvent des signes de perte de mobilité et de douleur qui s’aggravent si l’on tarde à traiter.
Boiterie ou refus d’appuyer sur la patte
La boiterie est l’un des premiers signes d’une rupture du LCC. Au début, la boiterie peut être légère et varier avec l’activité. Ensuite le chien risque de ne plus poser la patte du tout, ce qui surcharge la patte opposée et augmente le risque d’une nouvelle blessure.
Difficulté à se lever ou à se coucher
Les chiens peuvent mettre plus de temps pour se lever, hésiter avant de s’asseoir ou adopter des positions inhabituelles pour éviter la douleur. À la longue, cette réticence à bouger provoque raideur et aggravation de la douleur articulaire.
Perte musculaire progressive
Le manque d’utilisation de la patte entraîne une fonte musculaire. La patte affectée paraît plus fine. Cette perte de muscle réduit encore la stabilité du genou et complique la récupération si la situation reste sans traitement.
Signes de douleur chronique
La douleur chronique change aussi le comportement. Certains chiens deviennent agités, lèchent ou mâchouillent le genou, ou sont moins joueurs. Des modifications d’appétit et du sommeil peuvent aussi apparaître. Sans soin, la souffrance conduit souvent à l’arthrose.
Que prévoir immédiatement après l’opération ?
Les premiers jours sont cruciaux. Savoir ce qui est normal aide à bien gérer la convalescence.
Premières 24 heures après l’opération
Le chien sera somnolent et désorienté à cause de l’anesthésie. Il peut dormir plus et manger moins. La patte peut être enflée et contuse. La douleur doit être traitée avec les médicaments prescrits. Des antibiotiques peuvent être donnés selon le cas.
Première semaine : à quoi s’attendre
- Repos strict en cage : Maintenez le chien dans un espace confiné pour éviter les mouvements brusques. Offrez une litière confortable et un environnement calme.
- Promenades en laisse limitées : Courtes sorties uniquement pour les besoins. Évitez escaliers, sols glissants et terrains accidentés. Utilisez un harnais ou une sangle si nécessaire.
- Soins de l’incision : Vérifiez la plaie chaque jour. Pas de bain ni d’immersion tant que le vétérinaire n’autorise pas. Empêchez le léchage avec un collier protège-plaie ou une alternative recommandée.
Quand appeler le vétérinaire
Contactez le vétérinaire si vous voyez :
- Un gonflement excessif.
- Aucune mise en charge de la patte après 10 à 14 jours.
- Signes d’infection comme rougeur, chaleur, écoulement ou mauvaise odeur.
Calendrier de récupération et étapes clés
La récupération suit des étapes. La patience et la régularité donnent les meilleurs résultats.
Semaines 1 à 2 : repos strict
Repos en cage, promenades uniquement pour les besoins. Des exercices de mobilisation passive peuvent être indiqués. Surveillez l’incision chaque jour.
Semaines 3 à 4 : augmentation progressive de l’activité
Le chien commence à poser du poids. Promenades lentes plus longues. Toujours pas de course ou sauts. Glace après activité si le vétérinaire le recommande. Début possible de rééducation douce.
Semaines 5 à 6 : renforcement
Les promenades peuvent durer 10 à 15 minutes. Exercices de renforcement doux et hydrothérapie utiles. La mise en charge devient plus régulière.
Semaines 7 à 8 : regain de mobilité
Le chien marche plus confiant. Radiographie de contrôle fréquente. Si tout va bien, augmentation graduelle des activités surveillées.
3 à 6 mois : récupération complète
Retour aux activités normales. Maintien d’exercices à faible impact pour garder la force et protéger l’articulation.
Complications courantes et revers
La plupart des chiens récupèrent bien, mais des problèmes peuvent survenir. Les repérer tôt limite les séquelles.
Le chien boite encore après 4 semaines
Une boiterie légère à 4 semaines peut être normale. Mais si la boiterie s’aggrave ou reste sévère, cela peut indiquer un retard de guérison, une douleur persistante ou un problème d’implant. Signes alarmants : douleur accrue, sensibilité au toucher ou refus de marcher.
Risques d’infection
Les infections peuvent toucher la plaie ou la zone de l’implant. Signes : rougeur, écoulement purulent, odeur nauséabonde, fièvre ou perte d’appétit. Prévention : garder la plaie propre, empêcher le léchage et suivre le traitement prescrit. Si infection confirmée, des antibiotiques ou un nettoyage chirurgical peuvent être nécessaires.
Problèmes d’implant
Parfois la plaque ou les vis provoquent irritation, relâchement ou infection. Si douleur ou boiterie persistent, des radiographies permettront d’évaluer l’implant. Dans certains cas, on retire la plaque après la consolidation osseuse, souvent entre 6 et 12 mois.
Quand relancer la physiothérapie si la récupération stagne
La rééducation est essentielle. Si l’amélioration est lente après six semaines, commencez un programme structuré de physiothérapie : hydrothérapie, exercices d’équilibre, laser thérapeutique, massages et étirements. Si le chien ne supporte pas la mise en charge ou refuse de marcher, une réévaluation vétérinaire est nécessaire.
Prévenir des complications à long terme
Pour limiter les risques futurs :
- Maintenez un poids santé.
- Continuez les exercices à faible impact comme la natation.
- Évitez sauts et activités à fort impact, surtout chez les chiens âgés.
- Considérez les compléments articulaires si recommandés.
La surveillance régulière permet d’anticiper et de traiter rapidement tout problème.
Conclusion
La récupération après une TPLO demande du temps, de la patience et de la rigueur. Les premières semaines exigent un repos strict, puis les progrès deviennent visibles. En respectant le protocole de soin, en assurant des contrôles réguliers et en mettant en place une rééducation adaptée, la plupart des chiens retrouvent une vie active et sans douleur.
Fais confiance au plan proposé par ton vétérinaire et consulte le dès que tu observes un signe inquiétant. Avec de la constance et un bon suivi, ton chien pourra reprendre ses jeux et ses promenades, souvent plus fort qu’avant.
FAQ (brèves)
Combien de temps pour une récupération complète après TPLO ?
La récupération complète prend généralement 3 à 6 mois. Beaucoup de chiens montrent une amélioration notable dès 8 semaines, mais la consolidation osseuse et le retour complet de la force demandent plusieurs mois.
Mon chien peut-il marcher juste après la chirurgie TPLO ?
La plupart des chiens sont somnolents et peu actifs les premières 24 à 48 heures. Ils commencent à toucher le sol en quelques jours et à poser légèrement du poids vers la deuxième semaine sous surveillance.
Quand mon chien peut-il courir à nouveau ?
Il faut attendre au moins 12 à 16 semaines, et seulement si le vétérinaire confirme la guérison aux radiographies. La reprise doit être progressive pour éviter les rechutes.
Comment prévenir les complications après TPLO ?
Repos en cage, promenades en laisse contrôlées, soins quotidiens de l’incision et port d’un col protecteur. Respecte les médicaments et le programme de rééducation. Signes d’alerte : gonflement, écoulement, douleur persistante.
La TPLO empêche-t-elle l’arthrose ?
La TPLO ne supprime pas totalement l’arthrose, mais elle ralentit souvent sa progression en stabilisant le genou et en réduisant les mouvements anormaux qui détruisent le cartilage.

Chirurgie TPLO bilatérale expliquée
Guide complet sur la TPLO bilatérale chez le chien : procédure, récupération, avantages, risques et coût pour améliorer la mobilité.
Qu’est-ce que la chirurgie TPLO bilatérale ?
L’ostéotomie de nivellement du plateau tibial (TPLO) est une intervention chirurgicale utilisée pour traiter la rupture du ligament croisé crânien (LCC) chez le chien. Plutôt que de remplacer le ligament rompu, la TPLO modifie l’angle du plateau tibial, stabilisant l’articulation du genou et réduisant les mouvements anormaux.
La chirurgie TPLO bilatérale est pratiquée lorsque les deux genoux doivent être corrigés. Certains chiens souffrent de lésions du LCC sur les deux membres postérieurs, soit simultanément, soit dans un court laps de temps. Dans ces cas, le chirurgien peut recommander d’opérer les deux genoux en une seule procédure ou de procéder par interventions programmées (staged surgeries).
Les grandes races actives comme le Labrador Retriever, le Rottweiler, le Golden Retriever et le Berger allemand sont plus sujettes aux lésions du LCC en raison de leur gabarit et de leur niveau d’activité. L’obésité, la génétique et des prédispositions structurelles contribuent également à la dégénérescence ligamentaire, rendant parfois nécessaire une TPLO bilatérale. Une intervention précoce aide à restaurer la mobilité et à prévenir des dégâts articulaires à long terme.
Quand la chirurgie TPLO double ou bilatérale est-elle nécessaire ?
Certains chiens développent des lésions du ligament croisé crânien (LCC) dans les deux genoux, soit simultanément, soit à quelques mois d’intervalle. Cela survient souvent pour des raisons génétiques, par surcharge de l’autre membre après une première blessure, ou par usure progressive des ligaments dans les deux genoux. Lorsque les deux genoux sont instables, une TPLO bilatérale est nécessaire pour restaurer la mobilité et prévenir une dégradation articulaire supplémentaire.
Les chiens nécessitant une TPLO bilatérale présentent souvent des signes tels qu’une boiterie sévère, des difficultés à se lever, une réticence à marcher ou à jouer, et une posture assise inhabituelle. Ils peuvent trop déporter leur poids, ayant du mal à se soutenir sur l’un ou l’autre membre.
Les vétérinaires déterminent la nécessité d’une TPLO bilatérale via un examen orthopédique détaillé, une analyse de la démarche et des examens d’imagerie comme les radiographies. Si les deux genoux sont significativement instables, il est possible de recommander une TPLO simultanée pour corriger les deux genoux en une seule procédure.
Cependant, pour les chiens âgés ou présentant d’autres problèmes de santé, une approche étagée — opérer une patte d’abord puis la seconde après récupération — peut être plus sûre afin de réduire les risques chirurgicaux.
TPLO simultanée vs TPLO étagée : quel est le meilleur choix ?
Lorsqu’un chien a besoin d’une TPLO sur les deux genoux, les vétérinaires considèrent deux approches : la TPLO simultanée (opérer les deux pattes en même temps) ou la TPLO étagée (opérer une patte, laisser guérir, puis opérer l’autre).
TPLO simultanée
La TPLO simultanée offre l’avantage d’un seul acte anesthésique et d’une période de récupération globale plus courte. Les chiens retrouvent plus rapidement une mobilité équilibrée puisque les deux genoux guérissent ensemble.
Cependant, les soins post-opératoires sont plus exigeants car le chien ne peut pas s’appuyer sur une patte saine pour se soutenir ; il nécessite donc une assistance intensive de la part des propriétaires. Les risques comprennent un stress chirurgical accru et une probabilité plus élevée de complications post-opératoires comme le gonflement ou l’infection.
TPLO étagée
La TPLO étagée consiste à opérer un genou d’abord, puis l’autre après la convalescence. Cette approche réduit les risques chirurgicaux et convient mieux aux chiens âgés, fragiles ou présentant des comorbidités. En revanche, la période de traitement totale est plus longue et le chien peut continuer à souffrir du genou non traité pendant la récupération de la première patte.
Les vétérinaires décident de la meilleure option en fonction de la santé générale du chien, de son poids, de sa tolérance à la douleur et de la capacité du propriétaire à assurer les soins post-opératoires.
Les grands chiens avec des membres antérieurs puissants peuvent mieux tolérer une TPLO simultanée, tandis que les chiens plus petits ou plus faibles bénéficieront souvent d’une approche étagée.
Avantages d’effectuer une TPLO bilatérale en une seule fois
Pour les chiens nécessitant une TPLO sur les deux genoux, opter pour une TPLO bilatérale simultanée présente plusieurs avantages par rapport à des interventions espacées :
- Récupération globale plus rapide : en corrigeant les deux genoux en une seule chirurgie, le chien n’a qu’une seule phase de guérison au lieu de deux distinctes, ce qui permet un retour plus rapide aux activités normales.
- Coûts à long terme réduits : bien que l’opération simultanée puisse être plus coûteuse au départ, elle évite souvent les frais doublés d’anesthésie, d’hospitalisation et de soins postopératoires associés à deux interventions séparées.
- Prévention de la surcharge de l’autre patte : si seule une patte est opérée, l’autre risque de subir une surcharge menant à une aggravation ligamentaire ou à des déséquilibres musculaires. La TPLO simultanée supprime ce risque en traitant les deux genoux à la fois.
- Récupération de la mobilité plus équilibrée : la guérison conjointe des deux genoux favorise un renforcement et une stabilité plus homogènes, facilitant le retour aux activités sans altération de la démarche.
Pour les chiens jeunes, en bonne santé et actifs, la TPLO bilatérale peut être la meilleure option pour une récupération plus rapide et plus efficace.
Comment se déroule une TPLO double ?
Étape 1 : Préparation préopératoire
Avant la TPLO bilatérale, le vétérinaire réalise un bilan complet, incluant des radiographies pour mesurer l’angle tibial et confirmer la nécessité de la chirurgie. Des analyses sanguines vérifient l’aptitude du chien à l’anesthésie. Le chien est ensuite sédaté, intubé et placé sous anesthésie générale. Les zones opératoires des deux genoux sont rasées et désinfectées pour réduire le risque infectieux.
Étape 2 : Intervention chirurgicale
Le chirurgien pratique une incision sur chaque genou pour accéder au tibia. Une scie oscillante spécialisée est utilisée pour réaliser l’ostéotomie et faire pivoter le plateau tibial, corrigeant son angle afin de stabiliser l’articulation et d’éliminer le mouvement anormal causé par la rupture du LCC. Une fois repositionné, le plateau tibial est fixé par une plaque métallique et des vis pour maintenir la nouvelle position pendant la consolidation osseuse.
Pour réduire les risques de formation de biofilm et d’infections postopératoires, de nombreux chirurgiens emploient des solutions avancées comme Simini Protect Lavage, un lavage non antibiotique qui aide à éliminer les bactéries et à prévenir l’adhésion bactérienne, diminuant ainsi le risque d’infection et favorisant une récupération plus sûre.
Associées à des techniques chirurgicales stériles et à des antibiotiques postopératoires, ces mesures améliorent les chances de guérison et réduisent les complications.
Étape 3 : Stabilisation et suture
Une fois les deux genoux stabilisés, le chirurgien vérifie l’alignement. Les tissus mous et les muscles sont replacés avec soin avant la fermeture des incisions par sutures ou agrafes. Un pansement stérile peut être posé pour protéger la zone.
Étape 4 : Surveillance post-opératoire immédiate en clinique
Après l’intervention, le chien est amené en salle de réveil et surveillé étroitement pour la douleur, les saignements ou d’éventuelles complications. Des analgésiques et des antibiotiques sont administrés, et le vétérinaire s’assure que l’animal est stable avant de prévoir sa sortie. Les propriétaires reçoivent des instructions détaillées pour la prise en charge à domicile : gestion de la douleur, mobilité et soins des incisions.
Risques et complications potentielles de la TPLO double
Bien que la TPLO bilatérale soit très efficace, elle comporte des risques et des complications possibles que les propriétaires doivent connaître.
- Infection : infection superficielle ou profonde au site opératoire ou autour des implants. Le risque est réduit par des techniques stériles, des antibiotiques et des soins à domicile rigoureux (éviter que le chien lèche les sutures).
- Retard de cicatrisation : les deux pattes guérissant simultanément peuvent entraîner une récupération plus lente et un risque accru de difficultés fonctionnelles temporaires.
- Défaillance ou desserrage de l’implant : surtout chez les chiens très actifs ou en cas de non-respect des restrictions d’activité ; peut nécessiter une réintervention.
- Risques anesthésiques et douleur postopératoire : comme toute chirurgie majeure, il existe des risques liés à l’anesthésie, en particulier chez les chiens présentant d’autres problèmes de santé. La douleur est gérée par médicaments, mais demande une surveillance attentive.
Le respect strict des consignes postopératoires (repos, contrôle de la douleur, rééducation) réduit nettement ces risques.
À quoi s’attendre après une TPLO double ?
24–48 premières heures : gestion de la douleur et mobilité limitée
Immédiatement après l’opération, le chien est somnolent et peut éprouver une gêne. La gestion de la douleur est essentielle : AINS et opioïdes peuvent être prescrits. Les mouvements doivent être très limités ; le chien aura besoin d’aide pour se lever et sortir pour faire ses besoins (harnais, aide humaine).
2 premières semaines : repos strict et confinement
Un repos strict en cage ou dans un espace restreint est requis pour éviter sauts et mouvements brusques. Les promenades se limitent à de courtes sorties en laisse pour les besoins. Surveiller l’incision quotidiennement pour déceler signes d’infection ou de gonflement.
Semaines 3–6 : amélioration progressive, mouvement léger
Vers la troisième semaine, une appui léger peut réapparaître ; toutefois, l’activité reste restreinte. Des promenades très courtes (5–10 minutes) peuvent être autorisées si le vétérinaire l’approuve. Une faiblesse musculaire est fréquente.
Semaines 6–12 : début de la rééducation, vigilance quant aux complications
Avec l’accord du vétérinaire, débuter la rééducation : promenades contrôlées, tapis roulant subaquatique, exercices passifs d’amplitude articulaire. Signalez immédiatement toute boiterie excessive, douleur ou gonflement.
Récupération complète : marche, course et retour aux activités normales
Aux alentours de 12–16 semaines, la plupart des chiens marchent confortablement ; entre 4 et 6 mois, ils retrouvent une mobilité proche de la normale, y compris la course et le jeu. Les activités à fort impact doivent être réintroduites progressivement et sous supervision vétérinaire pour éviter les récidives.
Gestion de la douleur et médicaments après l’intervention
Une gestion efficace de la douleur est cruciale. Les vétérinaires prescrivent généralement une combinaison de médicaments :
- AINS (ex. Carprofen, Méloxicam) pour réduire inflammation et douleur. À administrer avec de la nourriture pour limiter l’irritation gastrique.
- Opioïdes (ex. Tramadol, Buprénorphine) peuvent être utilisés les premiers jours pour une analgésie plus forte.
- Compléments articulaires (glucosamine, chondroïtine, oméga-3) pour soutenir la santé articulaire à long terme.
- Cryothérapie : appliquer du froid 10–15 minutes, 2–3 fois par jour, pour réduire l’oedème.
Surveillez les signes de douleur excessive (gémissements, halètement, agitation, refus de bouger). Si la douleur persiste malgré le traitement, contactez le vétérinaire.
Importance de la physiothérapie et de la rééducation
La rééducation est déterminante pour accélérer la guérison et restaurer la mobilité après une TPLO bilatérale. Sans rééducation, le chien risque atrophie musculaire, raideur et inconfort prolongé.
Exercices recommandés :
- Étirements passifs : mouvements doux d’amplitude pour prévenir la raideur (2–3 fois/jour).
- Hydrothérapie (tapis subaquatique, natation) : exercice à faible impact qui renforce les muscles sans surcharger les articulations, généralement débuté 4–6 semaines après l’opération si autorisé.
- Promenades contrôlées : courtes marches progressives pour encourager l’appui et la mobilisation.
La plupart des exercices commencent vers 2–3 semaines postopératoires selon l’évolution. Les séances doivent être régulières mais courtes pour éviter la fatigue. Un plan de rééducation structuré, conduit par un vétérinaire ou un kinésithérapeute canin certifié, est le plus sûr et le plus efficace.
Soins à domicile et restrictions d’activité
Aménagez un espace calme et sécurisé : sol antidérapant, couchage moelleux, espace restreint pour éviter les mouvements brusques. Restreignez fortement l’activité pendant 8–12 semaines : pas de sauts, pas de course, pas d’escaliers.
Utilisez un harnais ou une sangle d’aide pour aider le chien à se lever et à se déplacer lors des sorties toilettes. Le manque d’exercice physique exige une stimulation mentale : jouets interactifs, casse-têtes alimentaires et jeux d’odorat pour prévenir l’ennui.
Une présence rassurante et des interactions calmes contribuent au bien-être pendant la convalescence.
Coût de la TPLO double et considérations financières
Le coût d’une TPLO bilatérale varie selon la localisation, l’expertise du chirurgien et les frais hospitaliers. Aux États-Unis, le coût moyen d’une TPLO par genou se situe entre 3 500 $ et 6 000 $, ce qui porte une TPLO bilatérale à environ 7 000 $ à 12 000 $. Dans d’autres régions (Canada, Royaume-Uni, Australie), les prix peuvent varier en fonction des coûts locaux.
Facteurs influençant le coût :
- Localisation géographique (zones urbaines plus chères)
- Expérience du vétérinaire (chirurgiens certifiés facturent davantage)
- Frais hospitaliers (anesthésie, soins postopératoires, médicaments, visites de contrôle)
Assurance animaux : certaines polices couvrent la TPLO si ce n’est pas une condition préexistante. Des options de financement existent (plans de paiement en clinique, CareCredit, Scratchpay, crowdfunding).
Réflexions finales sur la TPLO double ou bilatérale
La TPLO bilatérale est une solution très efficace pour les chiens présentant des lésions du LCC aux deux genoux. Bien que l’intervention requière un investissement important en temps, en coût et en soins postopératoires, les bénéfices à long terme — mobilité retrouvée, douleur réduite et meilleure qualité de vie — en font souvent une option valable.
Si la chirurgie n’est pas immédiatement envisageable, discutez avec votre vétérinaire des alternatives temporaires : physiothérapie, compléments articulaires, gestion du poids, attelles sur mesure. Ces mesures peuvent apporter un soulagement, mais ne constituent généralement pas une solution définitive.
Patience et engagement sont essentiels pour les propriétaires. Avec des soins appropriés et une rééducation structurée, la plupart des chiens retrouvent une vie active et heureuse. Restez en contact étroit avec votre vétérinaire, suivez les recommandations et faites confiance au processus de guérison.
FAQ
Un chien peut-il avoir une TPLO sur les deux pattes ?
Oui, un chien peut subir une TPLO bilatérale si les deux ligaments croisés sont rompus ou instables. La chirurgie peut être réalisée simultanément ou de manière étagée, selon la santé du chien et la recommandation du chirurgien.
Combien coûte une TPLO bilatérale ?
Le coût varie selon la région et la clinique. Aux États-Unis, il se situe généralement entre 7 000 $ et 12 000 $ pour les deux genoux. Les facteurs incluent l’expérience du chirurgien, les frais hospitaliers, les médicaments et le suivi postopératoire.
Quel est le temps de récupération pour une TPLO bilatérale ?
La récupération complète prend généralement 12 à 16 semaines. Les deux premières semaines nécessitent un repos strict ; entre la 3ᵉ et la 6ᵉ semaine, le mouvement léger est autorisé ; la rééducation débute autour de 6 à 12 semaines. La reprise complète des activités peut demander 4 à 6 mois.
Qu’est-ce que la TPLO bilatérale ?
C’est la réalisation d’une ostéotomie de nivellement du plateau tibial sur les deux genoux pour traiter les ruptures du ligament croisé crânien, afin de stabiliser les articulations et prévenir les mouvements anormaux.
Que se passe-t-il si un chien se déchire les deux LCC ?
Le chien souffrira d’une boiterie sévère, de douleurs et d’une démarche instable. Sans chirurgie, l’arthrose et la détérioration articulaire progresseront rapidement. Les options incluent la TPLO bilatérale, des attelles, la gestion du poids et la physiothérapie ; la chirurgie reste souvent la meilleure solution à long terme.

Qu’est-ce que la chirurgie TPLO chez le chien ?
Qu’est-ce que la TPLO chez le chien ? Une chirurgie pour soigner les ruptures du LCC, restaurer la mobilité et limiter l’arthrose. Découvrez la procédure, ses bénéfices, risques et la durée de récupération.
L’ostéotomie de nivellement du plateau tibial (TPLO) est une chirurgie utilisée pour traiter les ruptures du ligament croisé crânial (LCC) chez le chien. Contrairement aux méthodes traditionnelles qui tentent de remplacer ou d’imiter le ligament endommagé, la TPLO modifie la mécanique de l’articulation du genou afin de restaurer la stabilité.
La procédure consiste à couper la partie supérieure du tibia (l’os de la jambe) et à la faire pivoter pour obtenir une position plus plate. Ce changement réduit le glissement vers l’avant du fémur sur le tibia, supprimant le besoin du LCC. Une plaque et des vis spéciales maintiennent la nouvelle position, permettant à l’os de guérir avec le temps.
La TPLO est considérée comme plus efficace que les réparations extracapsulaires traditionnelles, qui utilisent des sutures artificielles pour imiter la fonction du ligament. Ces techniques peuvent échouer chez les chiens grands ou actifs. La TPLO offre une meilleure stabilité à long terme, une récupération plus rapide et un risque de complications plus faible, ce qui en fait le choix privilégié de nombreux vétérinaires pour traiter les ruptures du LCC.
Fonction du ligament croisé crânial (LCC)
Le ligament croisé crânial (LCC) est un élément stabilisateur clé de l’articulation du genou (grasset) du chien. Il relie le fémur (os de la cuisse) au tibia (os de la jambe) et empêche le mouvement excessif vers l’avant (poussée tibiale) ainsi que la rotation du tibia lorsque le chien marche, court ou saute. Le LCC aide aussi à répartir le poids de manière uniforme dans l’articulation, réduisant le stress sur le cartilage et limitant l’usure.
Lorsqu’il se rompt, l’articulation devient instable. Sans ce ligament, le fémur glisse anormalement sur le tibia, provoquant douleur, inflammation et boiterie. Les chiens atteints d’une rupture du LCC peuvent boiter, avoir des difficultés à poser la patte, éviter de courir ou sauter. Avec le temps, cette instabilité entraîne de l’arthrose, aggravant l’inconfort et limitant la mobilité.
Les lésions du LCC affectent fortement la capacité d’un chien à se déplacer confortablement. Beaucoup compensent en reportant le poids sur l’autre patte, augmentant ainsi le risque de rupture du second LCC. Si elle n’est pas traitée, une rupture du LCC peut causer douleur chronique, fonte musculaire et lésions articulaires irréversibles. L’intervention chirurgicale, comme la TPLO, est souvent la meilleure solution pour restaurer la fonction du genou, soulager la douleur et redonner une vie active au chien.
Indications pour la chirurgie TPLO : quels chiens en ont besoin ?
La chirurgie TPLO est le plus souvent recommandée pour les grandes races actives, car elles sont plus sujettes aux ruptures du LCC en raison de leur poids et de leur activité.
Des races comme le Labrador Retriever, le Golden Retriever, le Rottweiler, le Berger allemand ou le Boxer sont particulièrement à risque. Cependant, la TPLO peut aussi être bénéfique pour les chiens de taille moyenne ou petite, surtout s’ils présentent une instabilité persistante du genou.
Symptômes courants d’une rupture du LCC
- Boiterie ou appui limité sur une patte, surtout après l’exercice
- Raideur après repos, surtout le matin
- Gonflement et douleur autour du genou
- Difficulté à se lever, sauter ou monter les escaliers
- Aggravation progressive de la boiterie
Quand la chirurgie TPLO est-elle nécessaire ?
Une évaluation vétérinaire est essentielle pour déterminer le meilleur traitement. La TPLO est généralement indiquée si :
- Le chien est grand ou très actif, ce qui rend les autres réparations peu fiables
- L’instabilité du genou affecte fortement la mobilité
- La gestion conservatrice (repos, médicaments, physiothérapie) n’a pas amélioré les symptômes
Quand une prise en charge conservatrice peut fonctionner
Chez les petits chiens (< 15 kg) ou les chiens âgés et peu actifs, des solutions non chirurgicales (compléments, anti-inflammatoires, contrôle du poids, physiothérapie) peuvent être envisagées. Cependant, elles ne corrigent pas l’instabilité et l’arthrose continue de progresser.
Pour les grands chiens actifs, la TPLO reste la référence car elle restaure la stabilité et réduit le risque d’arthrose.
Mécanisme de la chirurgie TPLO
La TPLO vise à stabiliser le genou en modifiant la fonction du tibia. Normalement, à cause de la pente naturelle du plateau tibial, le fémur glisse vers l’avant lorsque le chien marche. Le LCC empêche ce mouvement, maintenant la stabilité.
Comment la TPLO modifie l’angle du plateau tibial
Lors de la TPLO, une coupe courbe (ostéotomie) est réalisée dans le haut du tibia. Le chirurgien fait pivoter l’os afin de réduire l’angle du plateau tibial (TPA) de 20–30° à environ 5–7°. Cette nouvelle position élimine la poussée tibiale (glissement vers l’avant).
Pourquoi le LCC n’est plus nécessaire
Après une TPLO, la stabilité du genou ne dépend plus du LCC. Le nouvel alignement osseux empêche le mouvement anormal. Le fémur repose en position neutre, et les forces sont mieux réparties. L’ostéotomie est ensuite fixée avec une plaque et des vis métalliques.
Biomécanique simplifiée
Avant la TPLO : la rupture du LCC laisse le tibia glisser vers l’avant à chaque pas, causant douleur et instabilité.
Après la TPLO : l’alignement osseux corrigé empêche ce mouvement, permettant au genou de fonctionner normalement sans ligament.
Étapes de la chirurgie TPLO
Préparatifs préopératoires
- Radiographies pour évaluer l’angle tibial et confirmer la rupture
- Analyses sanguines pour vérifier l’aptitude à l’anesthésie
- Jeûne 8–12 h avant la chirurgie
- Anesthésie générale, tonte et désinfection du membre
Étapes opératoires
- Coupe osseuse courbe : ostéotomie semi-circulaire dans la partie supérieure du tibia.
- Rotation du plateau tibial : correction de l’angle à 5–7° pour stopper le glissement.
- Fixation : mise en place d’une plaque et de vis pour maintenir la nouvelle position.
Durée et hospitalisation
- Chirurgie : 60–90 minutes
- Hospitalisation : 12–24 heures pour surveillance et gestion de la douleur
- Convalescence : 8–12 semaines avec restriction d’activité et radiographies de contrôle
Pourquoi la TPLO est-elle préférée aux autres méthodes ?
Comparaison avec d’autres techniques
- TTA (avancement de la tubérosité tibiale) : modifie la mécanique du tendon rotulien ; moins adaptée aux arthroses sévères.
- Suture latérale extracapsulaire : suture artificielle ; peu fiable chez les grands chiens car elle peut se rompre.
- Gestion conservatrice : réduit les symptômes mais ne stabilise pas le genou ; l’arthrose progresse.
Pourquoi la TPLO est le choix privilégié
- Taux de réussite 90–95 % avec une stabilité durable
- Reprise de l’appui dès quelques jours après chirurgie
- Meilleure option pour les grands chiens actifs
Bénéfices de la chirurgie TPLO
- Restauration de la stabilité : supprime l’instabilité et permet un mouvement fluide et sans douleur.
- Réduction du risque d’arthrose : stabilise le genou et ralentit la dégénérescence.
- Récupération plus rapide : reprise de l’appui en quelques jours ; mobilité normale en 8–12 semaines.
- Meilleurs résultats à long terme : 90–95 % de succès avec une reprise d’activité complète.
Risques et complications de la TPLO
Bien que la TPLO ait un haut taux de réussite, des complications existent :
- Échec de l’implant (plaque/vis qui bougent si le chien est trop actif)
- Fractures osseuses dues à l’affaiblissement du tibia
- Retard de cicatrisation osseuse (surtout chez les chiens âgés)
- Infections postopératoires : aujourd’hui réduites grâce à des solutions de lavage comme Simini Protect Lavage qui limitent la contamination bactérienne et le risque de biofilm.
Réduction des risques par des soins adaptés
- Restriction stricte d’activité pendant 8–12 semaines
- Suivi vétérinaire régulier avec radiographies
- Soins de la plaie et prévention des infections
- Rééducation contrôlée sous supervision
Taux de succès et résultats à long terme
- Taux de succès élevé : 90–95 % avec soulagement de la douleur et restauration de la mobilité.
- Pronostic à long terme : la plupart des chiens retrouvent une activité normale durable.
- Cas nécessitant un traitement complémentaire : arthrose sévère préexistante, complications d’implant, atteinte bilatérale du LCC.
Avec rééducation et suivi adaptés, la TPLO permet une vie active, sans douleur et avec peu de séquelles.
Conclusion
La chirurgie TPLO est un traitement très efficace des ruptures du LCC, en particulier chez les grandes races actives. En modifiant la biomécanique du genou, elle apporte stabilité, limite l’arthrose et favorise une récupération rapide par rapport aux méthodes traditionnelles.
Bien que des risques existent, des soins postopératoires adaptés et l’utilisation de méthodes modernes de prévention des infections permettent d’obtenir d’excellents résultats. Avec son haut taux de succès et sa capacité à restaurer une activité normale, la TPLO reste le choix de référence pour les vétérinaires.
FAQ
Combien de temps dure la récupération après une TPLO ?
Environ 8–12 semaines. La plupart des chiens reprennent l’appui en quelques jours, mais un retour progressif aux activités normales prend 3 mois, et une récupération musculaire complète jusqu’à 6 mois.
Un chien peut-il marcher immédiatement après une TPLO ?
Oui, généralement dans les 24–72 h. Mais les mouvements doivent rester très limités pour éviter les complications.
La TPLO empêche-t-elle l’arthrose ?
Non, elle ne la supprime pas totalement mais en ralentit fortement la progression grâce à la stabilisation du genou.
La physiothérapie est-elle nécessaire après une TPLO ?
Oui, elle accélère la récupération et réduit la raideur. Hydrothérapie, exercices contrôlés et renforcement musculaire sont recommandés.
Un chien peut-il déchirer le LCC de l’autre patte après une TPLO ?
Oui, le risque est de 40–60 % dans les 2 ans. Gestion du poids, compléments articulaires et activité contrôlée aident à réduire ce risque.
Les ecchymoses sont-elles normales après une TPLO ?
Oui, elles sont fréquentes et disparaissent en 1–2 semaines. Si elles s’aggravent ou persistent, il faut consulter le vétérinaire.

10 conseils essentiels pour la récupération après une chirurgie TPLO
Aidez votre chien à guérir plus vite après une TPLO grâce à 10 conseils simples et validés par les vétérinaires : repos, soins, alimentation et suivi post-opératoire
À quoi s’attendre après une TPLO ?
La TPLO (Tibial Plateau Leveling Osteotomy) est une chirurgie destinée à traiter une rupture du ligament croisé crânial (LCC) chez le chien. Elle consiste à couper et à faire pivoter le plateau tibial afin de stabiliser l’articulation sans le ligament.
Dans les premiers jours, votre chien peut présenter un gonflement, une douleur légère et une mobilité réduite. Le repos strict est alors indispensable. Le vétérinaire prescrira des antidouleurs et parfois des antibiotiques.
Au cours des premières semaines, le chien commence à poser progressivement du poids sur la patte. De courtes promenades en laisse et des exercices contrôlés peuvent être initiés sous supervision vétérinaire.
Entre 8 et 12 semaines, la majorité des chiens montrent une nette amélioration, même si la consolidation osseuse complète peut prendre jusqu’à 4 mois. Chaque chien cicatrise différemment, d’où l’importance des contrôles réguliers et des radiographies de suivi.
Semaine 1 : La phase de repos critique
1. Gardez votre chien au repos et en sécurité
La première semaine est consacrée au repos strict. Le corps doit initier la cicatrisation de l’os et des tissus mous. Placez votre chien dans une cage ou une petite pièce avec un couchage confortable pour limiter ses mouvements.
Évitez les escaliers, les courses et les sauts. Un environnement calme et sécurisé favorise une récupération plus solide.
2. Gérez la douleur et le gonflement
Administrez scrupuleusement les antidouleurs et anti-inflammatoires prescrits. Même si votre chien semble aller mieux, ne sautez pas de doses. Pour réduire l’inflammation, appliquez une poche de froid enveloppée dans une serviette sur la zone opérée pendant 10 à 15 minutes, 2 à 3 fois par jour, durant les 48 à 72 premières heures.
3. Aidez votre chien à marcher en sécurité
Ne sortez votre chien que pour ses besoins, toujours en laisse courte et à pas lents. Soutenez éventuellement l’arrière-train avec une serviette ou un harnais, surtout pour les grands chiens. Cela réduit la charge sur la patte opérée.
4. Protégez le site chirurgical
Un collier élisabéthain (E-collar) est indispensable pour éviter le léchage et les infections. Vérifiez la cicatrice chaque jour : rougeur, chaleur, écoulement ou mauvaise odeur nécessitent une consultation immédiate. Le site doit rester sec et propre, sans bain ni humidité.
Semaines 2–4 : Maintenir le cap de la récupération
5. Respectez une routine calme
Même si votre chien paraît mieux, il doit rester confiné. Les mouvements brusques ou l’excitation peuvent compromettre la cicatrisation. Gardez un rythme quotidien régulier et surveillez toujours ses déplacements.
6. Stimulez son esprit
Bien que le corps doive se reposer, le mental a besoin d’activité. Proposez des jouets à mâcher sûrs, des puzzles alimentaires ou des exercices d’obéissance simples. Cela évite l’ennui, diminue le stress et limite les comportements indésirables.
7. Maintenez une alimentation équilibrée
L’activité réduite favorise la prise de poids, ce qui surcharge l’articulation. Servez des repas équilibrés, contrôlez les portions et limitez les friandises. L’eau fraîche doit toujours être disponible. Un poids optimal soutient la guérison et la mobilité.
8. Créez un environnement propice à la guérison
Aménagez un espace calme, confortable et loin des sols glissants ou des autres animaux. Un couchage moelleux réduit la pression sur les articulations. Évitez les zones bruyantes ou très fréquentées pour limiter les stimulations.
Après la 4e semaine : retour progressif à la normale
9. Augmentez doucement les mouvements
Avec l’accord du vétérinaire, introduisez des promenades courtes en laisse et des exercices doux. Les signes favorables incluent une démarche stable, une bonne charge sur la patte et l’absence de douleur visible. Évitez encore courses, escaliers et jeux libres.
10. Ne négligez pas les suivis vétérinaires
Les visites de contrôle permettent d’évaluer la cicatrisation osseuse, la stabilité de l’implant et de détecter toute complication (infection, lésion méniscale, gonflement). Les radiographies guident la progression vers la physiothérapie et une reprise plus active.
Conclusion
La récupération après TPLO demande du temps, de la patience et des soins rigoureux. Du repos strict de la première semaine à la reprise progressive après un mois, chaque étape compte. Surveillez attentivement la cicatrice, maintenez un environnement sécurisé et respectez les consignes du vétérinaire.
Avec constance, vigilance et suivi médical, la majorité des chiens retrouvent une mobilité normale et une vie active après TPLO.
FAQ
Combien de temps dure la récupération après une TPLO ?
La plupart des chiens récupèrent en 8 à 12 semaines. La consolidation complète peut nécessiter jusqu’à 4 mois, avec repos, contrôles vétérinaires et reprise progressive des activités.
Puis-je laisser mon chien seul durant la convalescence ?
Oui, mais uniquement s’il est confiné dans un espace sécurisé (cage ou petite pièce). Évitez les zones où il pourrait sauter ou courir.
Que faire si mon chien refuse de rester calme ?
Offrez des jouets interactifs, des puzzles ou des exercices d’éducation douce. Si nécessaire, demandez à votre vétérinaire des solutions apaisantes adaptées.
La physiothérapie est-elle nécessaire après une TPLO ?
Pas toujours obligatoire, mais souvent bénéfique. Des exercices doux, la marche guidée ou l’hydrothérapie accélèrent la récupération.
Quels signes d’infection surveiller ?
Rougeur, chaleur, gonflement, écoulement, odeur désagréable, léchage excessif, boiterie persistante. Consultez immédiatement le vétérinaire en cas de doute.

13 signes que votre chien pourrait avoir besoin d’une chirurgie TPLO
Votre chien boîte ou ralentit ? Découvrez 13 signes précoces indiquant qu’une chirurgie TPLO peut être nécessaire pour une rupture du ligament croisé.
Qu’est-ce que la chirurgie TPLO et pourquoi les chiens en ont besoin
La TPLO (Tibial Plateau Leveling Osteotomy) est une chirurgie utilisée pour traiter les ruptures du ligament croisé crânial (LCC) chez le chien. Le LCC est un ligament clé qui stabilise l’articulation du genou. Lorsqu’il se rompt — à la suite d’un mouvement brusque ou d’une usure progressive — le chien peut boiter, éviter de poser sa patte ou montrer des signes de douleur et de raideur.
Plutôt que de réparer directement le ligament, la TPLO modifie l’angle du tibia (l’os de la jambe). Cela empêche le fémur de glisser vers l’avant et redonne de la stabilité au genou. L’os est coupé, pivoté, puis fixé par une plaque et des vis pour permettre la guérison.
La TPLO est l’une des chirurgies les plus efficaces pour les chiens souffrant de rupture du LCC. Elle réduit la douleur, améliore la mobilité et favorise une bonne fonction articulaire à long terme, en particulier chez les chiens de grande taille ou actifs.
Signes précoces que l’on peut manquer
Les lésions du LCC commencent souvent par de petits changements de comportement, faciles à négliger mais révélateurs d’une gêne articulaire. Surveillez notamment :
- Baisse d’activité ou fatigue inhabituelle : votre chien paraît plus fatigué, dort davantage ou montre moins d’intérêt pour les promenades.
- Réticence à jouer ou à bouger : un chien souffrant de douleurs articulaires évite souvent les jeux, la course ou l’exploration.
- Refus de sauter, courir ou monter les escaliers : ces mouvements deviennent douloureux et le chien hésite ou refuse de les faire.
Repérer ces signaux tôt permet d’intervenir avant que la lésion ne s’aggrave.
Signes modérés de gêne articulaire
Quand la blessure progresse, les symptômes deviennent plus visibles, surtout lors des mouvements ou au repos :
- Position assise inhabituelle : le chien s’assoit avec une patte tendue sur le côté pour soulager le genou douloureux.
- Raideur après repos : après s’être couché, le chien se relève difficilement et marche raide, surtout aux premiers pas.
- Boiterie intermittente : la boiterie apparaît après un effort puis disparaît, mais revient régulièrement.
- Appui léger « sur la pointe des doigts » : le chien effleure le sol avec ses orteils sans poser tout le poids.
Ces signes traduisent un stress articulaire nécessitant un suivi vétérinaire.
Signes avancés pouvant nécessiter une chirurgie
Quand le LCC est totalement rompu ou gravement endommagé, les symptômes deviennent évidents :
- Appui partiel sur une patte arrière : le chien évite de charger le poids et touche le sol seulement par moments.
- Boiterie persistante : la boiterie ne disparaît plus avec le mouvement et reste constante.
- Difficultés à se lever ou à s’asseoir : le chien peine à se relever ou adopte des positions maladroites.
- Sons de craquement ou de clic dans le genou : ces bruits indiquent souvent une instabilité ou une lésion méniscale.
- Gonflement autour du genou : l’articulation paraît enflée ou chaude, signe d’inflammation.
- Fonte musculaire d’un membre : la cuisse affectée devient visiblement plus fine à cause du manque d’utilisation.
Ces symptômes doivent être évalués rapidement par un vétérinaire pour envisager une chirurgie comme la TPLO.
Quand consulter le vétérinaire
Consultez si votre chien présente boiterie, raideur, difficultés à se lever ou appui « sur la pointe des doigts ». Ne négligez pas les changements soudains de comportement ou d’activité. Un diagnostic précoce améliore les chances de récupération.
L’examen vétérinaire comprend :
- palpation de la patte pour détecter la douleur, le gonflement et l’instabilité ;
- tests spécifiques (test du tiroir) pour confirmer la rupture du ligament ;
- radiographies, parfois sous sédation, pour évaluer l’articulation et exclure d’autres lésions osseuses.
Le vétérinaire proposera ensuite un traitement adapté : repos, médicaments ou chirurgie selon la gravité.
Conclusion
Les ruptures du LCC peuvent débuter par des signes discrets (fatigue, refus de jouer, posture anormale) et évoluer vers des symptômes sévères (boiterie persistante, fonte musculaire, gonflement). Reconnaître tôt ces signaux permet d’éviter des dommages articulaires irréversibles.
La chirurgie TPLO est très efficace pour restaurer la mobilité et le confort. Avec un diagnostic précoce et des soins adaptés, la plupart des chiens retrouvent une vie active et sans douleur.
Fiez-vous à votre instinct : si la démarche de votre chien change ou que vous notez des signes inhabituels, consultez rapidement votre vétérinaire.
FAQ
Quel est le signe le plus fréquent indiquant une TPLO ?
La boiterie persistante d’une patte arrière, surtout après repos ou activité, est le signe principal. Elle s’accompagne souvent de raideur, de posture anormale ou d’un appui partiel sur les orteils.
Ces signes apparaissent-ils soudainement ou progressivement ?
Les deux sont possibles. Certains chiens boitent soudainement après un effort, d’autres présentent une gêne progressive (ralentissement, hésitation dans les escaliers). Dans les deux cas, une évaluation vétérinaire est nécessaire.
La boiterie est-elle toujours liée à une rupture du LCC ?
Non. Elle peut aussi provenir d’entorses, de douleurs musculaires, d’arthrose ou de blessures aux coussinets. Mais une boiterie récurrente chez un chien actif ou de grande taille suggère souvent un LCC déchiré.
Comment le vétérinaire diagnostique-t-il une rupture du LCC ?
Par un examen physique (test du tiroir, tibial thrust), parfois sous sédation pour plus de précision. Les radiographies servent à écarter fractures et arthrose.
Que se passe-t-il si on retarde la chirurgie TPLO ?
Le retard augmente les risques de lésions méniscales, d’arthrose et de douleurs chroniques. Plus l’articulation reste instable, plus le pronostic fonctionnel s’aggrave. Une intervention rapide assure de meilleurs résultats.
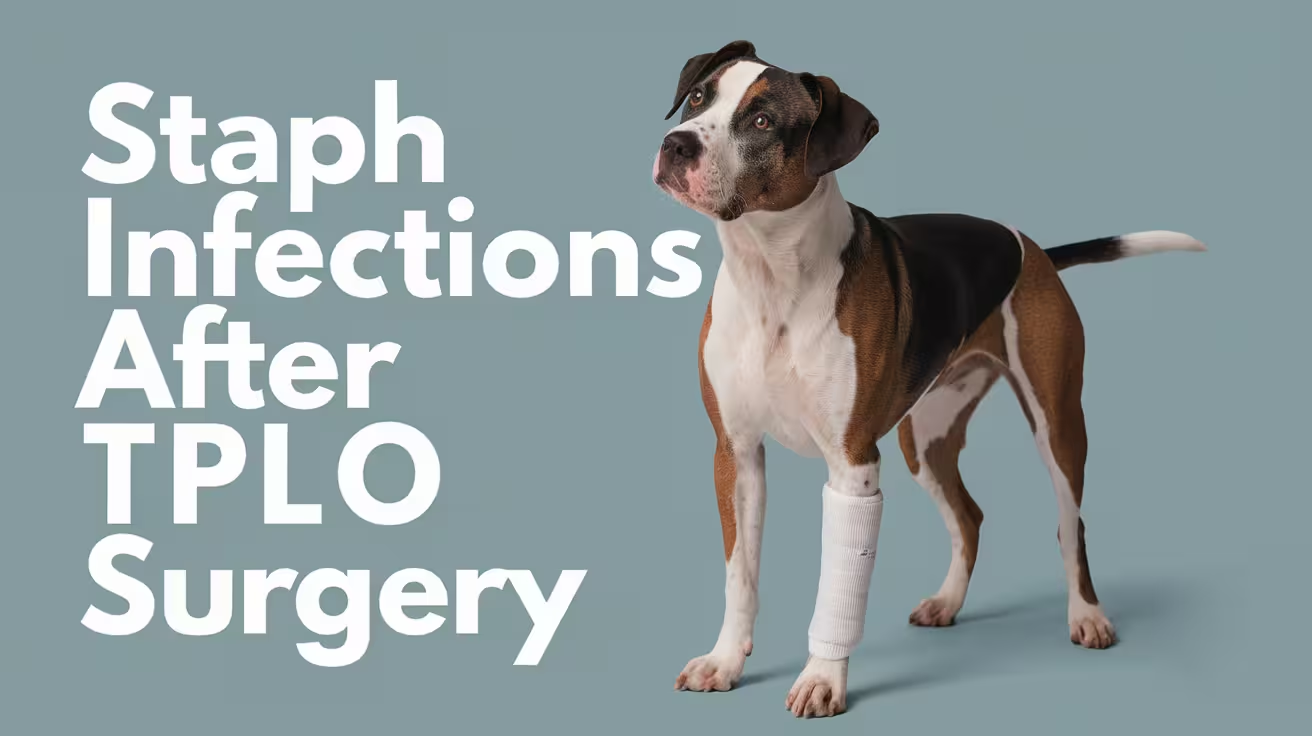
Infection à staphylocoque après une chirurgie TPLO : signes et risques
Les infections à staphylocoque après une chirurgie TPLO peuvent causer de graves complications. Découvrez les symptômes précoces, les traitements possibles et les moyens de prévention
Une infection à staphylocoque après une chirurgie TPLO (Ostéotomie de Nivellement du Plateau Tibial) est une infection bactérienne causée par des espèces de Staphylococcus au niveau du site opératoire. Ces infections apparaissent lorsque des bactéries pénètrent dans l’incision, entraînant inflammation, douleur, gonflement et, dans les cas graves, retard de cicatrisation ou problèmes liés aux implants.
Les bactéries les plus souvent impliquées sont :
- Staphylococcus pseudintermedius : naturellement présent sur la peau du chien, il peut devenir pathogène après une chirurgie.
- Staphylococcus aureus : moins fréquent chez le chien mais peut provoquer des infections sévères, parfois résistantes aux antibiotiques (comme le MRSA).
Les chirurgies TPLO sont particulièrement sujettes aux infections à cause des implants métalliques, qui offrent une surface propice à l’adhésion bactérienne et à la formation de biofilms. De plus, l’incision ouverte, le traumatisme chirurgical et le léchage ou grattage du chien augmentent le risque d’infection.
L’utilisation de techniques stériles appropriées, des soins post-opératoires rigoureux et une détection précoce des infections sont essentielles pour prévenir les complications et assurer une bonne récupération.
TL;DR
- Les infections à staphylocoque après TPLO sont rares mais possibles, avec S. pseudintermedius comme principale cause.
- Un traitement antibiotique précoce est essentiel car ces infections ne guérissent pas seules et peuvent causer des complications graves.
- Non traitées, elles peuvent entraîner une ostéomyélite, une défaillance de l’implant ou une infection généralisée.
- Des soins postopératoires stricts et une surveillance quotidienne de l’incision sont indispensables.
- Dans les cas sévères, le retrait de la plaque TPLO peut être nécessaire.
Causes d’une infection à staphylocoque après une chirurgie TPLO
Les infections apparaissent lorsque les bactéries pénètrent et se multiplient au niveau du site chirurgical, provoquant une réponse inflammatoire.
- Contamination du site chirurgical : malgré la stérilité, les bactéries de la peau ou du matériel peuvent pénétrer.
- Mauvais soins postopératoires : pansements sales, absence de nettoyage ou léchage de la plaie par le chien favorisent l’infection.
- Immunité affaiblie : chiens âgés, diabétiques ou sous corticoïdes sont plus vulnérables.
- Bactéries hospitalières vs environnementales : certaines, comme le MRSA, sont résistantes et difficiles à traiter.
Facteurs de risque
- Liés au chien : âge, maladies chroniques, obésité, plis cutanés (Bulldog, Boxer).
- Liés à la chirurgie : durée prolongée, implants contaminés, conditions non stériles.
- Liés aux soins postopératoires : léchage, literie sale, mauvaise hygiène.
De nombreux chirurgiens utilisent le Simini Protect Lavage, une solution non antibiotique qui réduit la contamination bactérienne et la formation de biofilms sur les implants.
Symptômes d’une infection à staphylocoque après TPLO
- Signes précoces : rougeur, chaleur, gonflement léger, inconfort persistant, léchage accru.
- Signes modérés : écoulement purulent, odeur, plaie humide ou qui s’ouvre, boiterie accrue.
- Signes sévères : fièvre, abattement, perte d’appétit, infection osseuse, implant instable.
Diagnostic
- Examen clinique : inspection de l’incision, recherche de chaleur, douleur et écoulements.
- Culture bactérienne + antibiogramme : identification de la souche et choix du traitement efficace (utile contre MRSP).
- Imagerie : radiographies ou scanner si suspicion d’atteinte osseuse ou d’implant.
Rôle des bactéries multirésistantes
- MRSP (Staphylococcus pseudintermedius résistant à la méthicilline) est fréquent après chirurgie.
- Résiste à de nombreux antibiotiques classiques (pénicillines, céphalosporines).
- Allonge la durée de traitement et complique la guérison.
- Nécessite souvent chirurgie + traitements spécifiques.
Biofilms sur les implants
- Les bactéries forment un biofilm protecteur sur les plaques et vis TPLO.
- Protège les bactéries des antibiotiques et du système immunitaire.
- Rend l’infection chronique et difficile à éradiquer.
- Peut nécessiter une réintervention ou un retrait d’implant.
Complications possibles
- Rejet ou défaillance de l’implant : la plaque se desserre.
- Ostéomyélite : infection osseuse grave.
- Récupération prolongée et coûts accrus.
- Amputation dans les cas extrêmes.
Options de traitement
- Antibiotiques : adaptés selon antibiogramme (Clindamycine, Céphalexine, fluoroquinolones en cas de résistance).
- Soins locaux : nettoyage antiseptique, pansements, collier élisabéthain.
- Gestion de la douleur : AINS, antalgiques.
- Chirurgie : débridement, retrait ou remplacement d’implant.
Importance de la détection précoce
- Les infections détectées tôt sont plus faciles à traiter.
- Retard de traitement = biofilm, ostéomyélite, implant à retirer.
- Suivi vétérinaire régulier et vigilance quotidienne de l’incision indispensables.
Prévention
- Avant la chirurgie : environnement stérile, prophylaxie adaptée aux chiens à risque.
- Après la chirurgie : plaie propre et sèche, pas de léchage, pas de baignade, literie propre.
- Long terme : suivi vétérinaire, bonne alimentation, compléments pour soutenir l’immunité.
Conclusion
Les infections à staphylocoque après TPLO peuvent entraîner des complications graves (implant instable, infection osseuse, récupération retardée). Les signes comme rougeur, gonflement ou écoulement doivent alerter immédiatement.
Une détection rapide, un traitement antibiotique adapté et des soins locaux évitent les évolutions sévères. La prévention repose sur des soins postopératoires rigoureux, une hygiène stricte et une vigilance continue.

Quand les chiens peuvent-ils reprendre l’entraînement d’agility après une TPLO ?
Découvrez quand et comment reprendre l’agility après une TPLO : étapes de rééducation, signaux de readiness, conseils vétérinaires et précautions pour éviter les récidives
L’agility est-il possible après une TPLO ?
Oui, de nombreux chiens peuvent reprendre l’agility après une chirurgie TPLO, mais cela nécessite de la patience, un plan de rééducation structuré et une supervision vétérinaire attentive. Le temps de récupération varie selon l’âge, l’état de santé général et la gravité de la blessure initiale.
Un programme de rééducation bien conçu, incluant des exercices contrôlés, du renforcement musculaire et une reprise progressive de l’activité, est essentiel. La majorité des chiens retrouvent une bonne fonction et peuvent participer à l’agility, même si certains ne reviennent pas toujours à leur niveau de performance initial. Des ajustements d’entraînement peuvent être nécessaires pour réduire le stress articulaire.
La gestion du poids, l’utilisation de compléments articulaires et un conditionnement régulier soutiennent la santé articulaire à long terme. L’autorisation vétérinaire reste indispensable avant toute reprise d’activités à fort impact. Reprendre trop tôt augmente fortement le risque de blessure ou de problèmes chroniques.
Combien de temps faut-il pour reprendre l’agility après une TPLO ?
Le délai moyen de retour à l’agility après une TPLO est d’environ sept mois. Certains chiens commencent une activité contrôlée dès six mois, tandis que d’autres mettent jusqu’à deux ans pour récupérer totalement.
Les principaux jalons de récupération :
- Semaines 1–12 : gestion de la douleur, réduction de l’œdème, récupération de la mobilité et début du renforcement musculaire.
- Mois 3–4 : introduction d’activités modérées comme la marche en laisse prolongée et les exercices contrôlés.
- À partir de 6 mois : possibilité de commencer des exercices légers d’agility (tunnels, virages doux).
- Sauts et slaloms : uniquement lorsque la force et la coordination sont complètement revenues, sous validation vétérinaire.
Un suivi strict par le vétérinaire est indispensable pour sécuriser chaque étape.
Facteurs influençant le succès du retour à l’agility
Rôle de l’expertise vétérinaire
Une chirurgie TPLO correctement réalisée aligne l’os et stabilise l’articulation, mais la réussite repose aussi sur le suivi post-opératoire. Analgésie, anti-inflammatoires et radiographies de contrôle (8–12 semaines) sont essentiels pour guider la rééducation.
Importance de la rééducation et de la physiothérapie
Les exercices contrôlés (mobilisation passive, transferts de poids, hydrothérapie) renforcent les muscles et limitent la perte de mobilité. Les exercices d’équilibre (disques, planches instables) améliorent la coordination et réduisent les risques de récidive.
Réintroduction progressive de l’entraînement
- Phase 1 : marche en laisse contrôlée → jogging léger.
- Phase 2 : exercices de renforcement (assis-debout, cavaletti).
- Phase 3 : introduction progressive des éléments d’agility (tunnels, slalom doux).
- Phase 4 : sauts en dernier, en commençant bas puis en augmentant graduellement.
Signes que le chien est prêt à reprendre l’agility
- Absence de boiterie ou de douleur après l’activité modérée.
- Symétrie musculaire entre les deux pattes arrière.
- Mobilité complète et absence de raideur à l’examen vétérinaire.
- Confiance et fluidité dans les mouvements quotidiens.
Surveillance des complications post-TPLO
Même après une récupération réussie, des complications peuvent survenir : œdème persistant, douleur après effort, boiterie occasionnelle ou gêne au niveau de l’implant.
Une surveillance vétérinaire régulière permet d’ajuster le programme de rééducation. Tout signe de boiterie récurrente, de fièvre ou de sensibilité locale nécessite une consultation rapide.
L’expérience du propriétaire compte-t-elle ?
Oui. Un maître expérimenté en agility ou un éducateur qualifié détecte plus vite les signes de gêne et adapte l’entraînement. Une reprise progressive, sans précipitation, réduit considérablement les risques de récidive.
Chaque chien récupère différemment
- Jeunes chiens sportifs → récupération plus rapide.
- Chiens âgés ou en surpoids → progression plus lente, parfois avec ajustements (sauts plus bas, entraînements moins intensifs).
L’objectif n’est pas forcément de revenir à la performance d’avant, mais de pratiquer l’agility de façon sûre et durable.
Conclusion
De nombreux chiens reprennent l’agility après une TPLO, mais le succès repose sur :
- une rééducation progressive,
- un suivi vétérinaire rigoureux,
- et une attention particulière aux signes de douleur ou de fatigue.
Tous les chiens ne retrouveront pas leur niveau de compétition antérieur, mais avec des ajustements adaptés et une approche patiente, l’agility reste possible et agréable, tout en protégeant la santé articulaire à long terme.

Mythes courants sur la chirurgie TPLO chez le chien
Découvrez la vérité sur la chirurgie TPLO. Nous expliquons les mythes courants avec des faits vétérinaires clairs pour mieux soigner la santé de votre chien
La chirurgie TPLO (ostéotomie de nivellement du plateau tibial) est reconnue comme l’un des meilleurs traitements pour les ruptures du ligament croisé crânien (LCC) chez le chien, équivalentes aux blessures du ligament croisé antérieur (LCA) chez l’homme. Cette opération a considérablement amélioré les résultats, permettant aux chiens de retrouver leur mobilité et de vivre sans douleur.
Malgré son succès, plusieurs mythes entourent encore la chirurgie TPLO. Ces idées fausses peuvent retarder le choix de cette intervention et priver certains chiens des meilleurs soins.
Connaître les faits est essentiel pour prendre de bonnes décisions concernant la santé de votre chien. Dans cet article, nous allons clarifier les idées reçues, en vous donnant des informations claires et basées sur des preuves pour vous aider à choisir sereinement les meilleurs soins.
Mythe 1 – La chirurgie TPLO n’est pas toujours nécessaire pour les ruptures du LCC
Bien que la TPLO soit le traitement de référence pour les ruptures du LCC, elle n’est pas nécessaire dans tous les cas. Pour les déchirures partielles ou les chiens peu actifs, des alternatives comme la technique de la suture latérale ou une prise en charge conservatrice (perte de poids, physiothérapie) peuvent suffire. Ces options conviennent souvent mieux aux petites races ou aux chiens âgés avec une instabilité articulaire limitée.
En revanche, pour les chiens actifs ou en cas de rupture complète, la TPLO reste le meilleur choix. Cette chirurgie stabilise le genou en modifiant sa biomécanique, limitant ainsi les lésions secondaires et réduisant fortement le risque d’arthrose. Pour les chiens sportifs ou très actifs, cette stabilité est indispensable pour préserver leur qualité de vie.
Mythe 2 – La chirurgie TPLO est réservée aux grands chiens
Une idée reçue fréquente est que la TPLO concerne surtout les grands chiens. À l’origine, elle a en effet été développée pour eux, car leur poids et leur taille rendaient les autres techniques moins efficaces.
Aujourd’hui, nous savons que la TPLO est tout aussi bénéfique pour les petites races. L’intervention est simplement adaptée à l’anatomie de chaque chien, qu’il s’agisse d’un Chihuahua de 2 kg ou d’un Labrador de 45 kg. Le principe reste identique : stabiliser le genou, réduire la douleur et prévenir les complications.
Mythe 3 – La chirurgie TPLO n’est utile que pour les chiens de compétition
Certains pensent que la TPLO est réservée aux chiens de concours ou de sport. Bien sûr, ces chiens en profitent pour rester performants, mais la réalité est que tout chien nécessitant une stabilité durable du genou peut en bénéficier.
Dans la pratique, cette chirurgie est réalisée aussi bien sur des chiens de compagnie que sur des chiens de travail. Elle n’a pas pour but de préparer à une carrière sportive, mais de permettre à chaque animal de marcher, courir et jouer sans douleur. Même pour un chien de famille, elle améliore nettement la mobilité et la qualité de vie.
Mythe 4 – La récupération après une TPLO est extrêmement difficile
Il est normal que les propriétaires craignent la convalescence, mais avec de bons soins, elle est généralement simple et très positive. La plupart des chiens commencent à reposer leur patte opérée en quelques jours et retrouvent une activité quasi normale au bout de 12 semaines.
La récupération suit un protocole précis : repos strict les deux premières semaines, puis reprise progressive de l’activité avec suivi vétérinaire et éventuellement de la physiothérapie. Les étapes de contrôle à 4, 8 et 12 semaines permettent d’adapter les exercices et d’assurer une guérison optimale.
Les propriétaires attentifs qui suivent ces recommandations voient souvent leur chien récupérer plus vite et avec peu de complications.
Mythe 5 – La chirurgie TPLO comporte beaucoup de risques
Comme toute chirurgie, la TPLO n’est pas totalement sans risques, mais les progrès vétérinaires ont considérablement amélioré la sécurité. Les techniques modernes, le matériel avancé et les protocoles d’asepsie stricts réduisent fortement les complications.
Pour limiter encore plus les risques d’infections, certains chirurgiens utilisent des solutions innovantes comme Simini Protect Lavage, qui nettoie activement la zone opératoire, réduit les bactéries et empêche la formation de biofilm. Grâce à ces mesures, la TPLO est aujourd’hui une intervention fiable et sûre.
Mythe 6 – La douleur après TPLO est très intense
Beaucoup imaginent que la TPLO entraîne une douleur sévère. En réalité, la douleur postopératoire est bien contrôlée grâce à une approche multimodale. Les vétérinaires associent anti-inflammatoires, anesthésiques locaux et parfois opioïdes à court terme pour assurer un confort optimal.
Mais la prise en charge ne s’arrête pas aux médicaments : les suivis réguliers, l’éducation des propriétaires et les plans de rééducation personnalisés permettent une récupération sereine. Avec ces mesures, la plupart des chiens reprennent une activité normale dans les délais prévus.
Mythe 7 – La chirurgie TPLO est trop coûteuse
Le coût de la TPLO, généralement entre 3 000 et 6 000 dollars, inquiète de nombreux propriétaires. D’autres techniques comme la suture latérale coûtent parfois moins cher (1 000 à 2 500 dollars), mais elles sont moins durables et peuvent nécessiter des réinterventions.
La TPLO, bien qu’exigeante sur le plan technique, offre une stabilité à long terme, ralentit l’arthrose et évite souvent des chirurgies supplémentaires. Pour un chien actif ou présentant une rupture complète, il s’agit d’un investissement rentable pour préserver sa mobilité et son bien-être.
Mesures proactives pour assurer le succès d’une TPLO
Pour optimiser les résultats de cette chirurgie, il est essentiel de suivre certaines étapes clés :
- Respecter les soins postopératoires : surveiller l’incision, gérer l’activité et se rendre aux contrôles vétérinaires.
- Prévenir les infections : maintenir la plaie propre et, si utilisé, profiter de solutions comme Simini Protect Lavage qui réduisent la contamination.
- Gérer l’activité : limiter les efforts (pas de courses, sauts, escaliers) et réintroduire progressivement les exercices selon les conseils du vétérinaire.
Conclusion
Les idées reçues sur la TPLO peuvent faire hésiter certains propriétaires et retarder une intervention bénéfique. En expliquant clairement les faits, nous souhaitons donner aux maîtres la confiance nécessaire pour offrir les meilleurs soins à leur chien.
Grâce aux progrès chirurgicaux, la TPLO est devenue une option sûre et efficace, adaptée à toutes les races et à tous les modes de vie. Elle permet à de nombreux chiens de retrouver une vie active et sans douleur. Pour chaque cas, l’accompagnement et les conseils personnalisés de votre vétérinaire restent essentiels.

Infection de l’Incision après TPLO : Symptômes et Prévention
Inquiet d’une infection de l’incision après TPLO ? Découvrez les symptômes, les causes et les meilleurs conseils de prévention pour assurer une récupération fluide et sans infection de votre chien
La chirurgie TPLO (Ostéotomie de Nivellement du Plateau Tibial) est une procédure courante visant à stabiliser le genou d’un chien après une rupture du ligament croisé crânien (LCC). Elle consiste à couper et repositionner le tibia pour réduire la tension sur le ligament et améliorer la fonction articulaire. Comme toute chirurgie, la TPLO comporte des risques de complications, l’infection de l’incision étant l’une des principales préoccupations.
Les infections peuvent survenir en raison d’une contamination bactérienne pendant l’opération, d’un mauvais suivi post-opératoire, d’un léchage ou mordillement excessif de l’incision, ou encore de conditions sous-jacentes comme le diabète ou une immunité affaiblie. Les signes d’infection incluent rougeur, gonflement, chaleur, écoulement et retard de cicatrisation.
Le risque d’infection après TPLO reste relativement faible, touchant environ 3 à 10 % des cas. Des facteurs comme la technique chirurgicale, les conditions de stérilité et une gestion stricte du post-opératoire influencent fortement le résultat. Une détection précoce et un traitement rapide par antibiotiques et soins de plaie sont essentiels pour éviter les complications et assurer une guérison réussie.
Symptômes et Signes d’Alerte d’une Infection de l’Incision TPLO
Reconnaître tôt les signes d’infection est crucial pour prévenir les complications après une TPLO. Les infections peuvent être bénignes ou graves, affectant potentiellement la guérison et le succès de la chirurgie.
Signes précoces d’infection
Aux premiers stades, une infection peut ressembler à une cicatrisation normale :
- Rougeur et gonflement autour de l’incision, parfois chaude au toucher.
- Douleur légère persistante au-delà de l’inconfort post-opératoire attendu.
- Écoulement clair ou jaunâtre léger.
À ce stade, le traitement par antibiotiques et soins locaux permet souvent un bon contrôle.
Signes avancés d’infection
Si l’infection progresse :
- Écoulement épais, purulent, avec une odeur nauséabonde.
- Gonflement marqué et chaleur importante autour de l’incision.
- Fièvre et abattement.
- Boiterie aggravée ou refus d’appui sur la patte.
Ces cas nécessitent une prise en charge vétérinaire urgente.
Causes d’Infection de l’Incision TPLO
Contamination bactérienne
Malgré des protocoles stériles stricts, des bactéries peuvent pénétrer dans le site opératoire. Une exposition ultérieure à des environnements souillés augmente aussi le risque.
Mauvais soins post-opératoires
Oublier de nettoyer la plaie, d’administrer les antibiotiques ou de respecter les visites de contrôle favorise les infections.
Léchage ou mordillement
Les chiens lèchent instinctivement leurs plaies, introduisant ainsi des bactéries. L’utilisation d’une collerette (E-collar) ou d’un vêtement médical est indispensable.
Humidité autour de l’incision
Un environnement humide (bains, literie mouillée) favorise la croissance bactérienne.
Conditions médicales sous-jacentes
Les chiens diabétiques ou immunodéprimés cicatrisent plus lentement et sont plus exposés.
Rôle des implants
Les plaques et vis métalliques peuvent devenir le support d’un biofilm bactérien. Pour limiter ce risque, de nombreux chirurgiens utilisent Simini Protect Lavage, une solution non antibiotique qui empêche l’adhésion bactérienne et réduit les infections postopératoires.
Diagnostic d’une Infection de l’Incision TPLO
Examen clinique
Le vétérinaire évalue :
- Rougeur, gonflement, chaleur.
- Écoulements anormaux.
- Douleur à la palpation.
- Signes généraux comme la fièvre ou l’abattement.
Examens complémentaires
- Culture bactérienne pour identifier le germe.
- Hémogramme pour mesurer la réponse immunitaire.
- Radiographies ou échographie si suspicion d’infection profonde ou atteinte des implants.
Complications Possibles d’une Infection Non Traitée
- Échec ou retrait de l’implant : colonisation bactérienne nécessitant une réintervention.
- Ostéomyélite (infection osseuse) : infection sévère et difficile à traiter.
- Retard de cicatrisation, douleur chronique et boiterie.
- Septicémie : infection généralisée grave et potentiellement mortelle.
Options de Traitement
Antibiothérapie
- Antibiotiques oraux pour infections modérées.
- Topiques pour infections superficielles.
- Intraveineux si l’infection est sévère.
Soins locaux
- Nettoyage antiseptique (chlorhexidine, povidone diluée).
- Maintien de l’incision propre et sèche.
- Prévention du léchage (E-collar).
Gestion de la douleur
- AINS (carprofène, méloxicam).
- Antalgiques plus puissants si nécessaire.
Chirurgie
- Lavage et débridement si tissu infecté.
- Retrait ou remplacement des implants si biofilm établi.
Quand Contacter le Vétérinaire
Appelez rapidement si :
- Gonflement ou rougeur excessive.
- Écoulement purulent ou odorant.
- Douleur intense ou boiterie persistante.
- Fièvre, abattement, perte d’appétit.
Une intervention rapide améliore le pronostic et évite des complications graves.
Prévention d’une Infection Après TPLO
- Soins quotidiens de l’incision : inspection, nettoyage, hygiène stricte.
- Collerette obligatoire jusqu’à cicatrisation complète.
- Maintien au sec (pas de bains, literie propre).
- Suivi vétérinaire rigoureux avec contrôles programmés.
- Observation constante pour détecter rapidement tout changement.
Conclusion
Une infection de l’incision après TPLO peut ralentir la guérison et mettre en danger le succès de la chirurgie. La vigilance est donc essentielle : reconnaître les signes précoces, respecter les soins post-opératoires et consulter rapidement le vétérinaire en cas de doute.
Grâce à une prise en charge rapide et à des mesures de prévention adaptées (soins, collerette, antiseptiques, Simini Protect Lavage), la majorité des chiens récupèrent bien et retrouvent leur mobilité sans complications.

Déchirure du ménisque chez le chien après TPLO
Comprenez les causes, les symptômes et les options de traitement des déchirures méniscales chez le chien après une TPLO. Conseils pratiques pour favoriser la récupération et prévenir les complications.
Le ménisque est un cartilage en forme de C dans l’articulation du genou (jarret) du chien qui amortit et stabilise le mouvement. Il absorbe les chocs et répartit le poids de manière uniforme sur l’articulation, évitant une usure excessive des os. Chaque genou comporte deux ménisques — médial (interne) et latéral (externe). Le ménisque médial est plus sujet aux blessures car il est fortement attaché au tibia.
Après une TPLO (ostéotomie de nivellement du plateau tibial), des déchirures méniscales peuvent encore survenir, même si la procédure stabilise le genou. Cela peut se produire en raison d’une instabilité articulaire persistante avant la chirurgie, d’un traumatisme direct ou de modifications dégénératives. Dans certains cas, le ménisque était déjà endommagé avant la TPLO mais la lésion n’a pas été détectée.
Les déchirures méniscales provoquent souvent douleur, boiterie et bruits de cliquetis dans le genou. Certains chirurgiens pratiquent une libération méniscale (meniscal release) lors de la TPLO pour réduire les risques postopératoires, mais cette manœuvre peut altérer la fonction articulaire. La détection et le traitement précoces sont essentiels pour prévenir des problèmes de mobilité à long terme.
Causes des déchirures méniscales après une TPLO
Les déchirures méniscales après TPLO peuvent survenir pour plusieurs raisons, même si le genou est chirurgicalement stabilisé. Alors que la TPLO vise à prévenir de nouveaux dommages, certaines conditions peuvent continuer à solliciter le ménisque et provoquer une lésion.
- Forces excessives ou anormales pendant la guérison — Après la TPLO, l’articulation porte encore du poids. Si un chien est trop actif trop tôt, une contrainte excessive sur le ménisque peut provoquer une déchirure. Des mouvements brusques, un glissement ou des sauts avant une guérison complète exercent une pression anormale sur le cartilage.
- Lésion méniscale préexistante — Parfois, le ménisque est déjà partiellement déchiré avant la TPLO mais n’est pas visible lors de l’intervention. Une déchirure partielle peut évoluer en déchirure complète avec le temps, surtout si l’articulation reste irritée ou inflammée.
- Mauvais alignement tibial après la chirurgie — Si le tibia n’est pas correctement réaligné pendant la TPLO, une instabilité résiduelle peut persister et entraîner des contraintes répétées sur le ménisque. Un geste chirurgical imparfait ou des variations anatomiques individuelles peuvent provoquer ce problème, causant des dommages articulaires même après l’intervention.
Symptômes d’une déchirure méniscale chez le chien
Une déchirure méniscale après TPLO peut entraîner un inconfort important et des difficultés de mobilité. Bien que certains symptômes se recoupent avec d’autres problèmes du genou, certains signes orientent fortement vers une lésion méniscale.
- Boiterie ou claudication — Un chien avec un ménisque déchiré présente souvent une rechute de la boiterie après une amélioration initiale post-TPLO. La boiterie peut être intermittente et s’aggraver après l’effort.
- Difficulté à appuyer sur la patte concernée — Le chien peut hésiter à mettre tout son poids sur la patte atteinte, parfois la soulevant en station. Certains déplacent leur poids sur la patte opposée, entraînant une posture inégale.
- Gonflement autour de l’articulation du genou — Une inflammation du jarret peut apparaître, rendant la zone chaude ou enflée au toucher, signe d’irritation ou de lésion interne.
- Douleur ou sensibilité à la palpation — Le chien peut réagir lors de l’examen du genou, en se retirant, en gémissant ou en léchant la zone.
- Réticence à l’effort — Un chien auparavant actif peut devenir moins enclin à marcher, courir ou monter les escaliers par douleur. Si elle n’est pas traitée, cette inactivité peut provoquer une fonte musculaire et aggraver les problèmes articulaires.
Diagnostic d’une déchirure méniscale après TPLO
Le diagnostic d’une déchirure méniscale après TPLO repose sur un examen clinique associé à des outils diagnostiques avancés. Comme les symptômes peuvent imiter d’autres pathologies du genou, une évaluation complète est nécessaire.
- Examen physique et manipulation manuelle — Le vétérinaire observe la démarche, le gonflement et la réponse douloureuse. Un test clé est le signe du « cliquetis méniscal » : une sensation de cliquetis ou de ressaut lors de la flexion et de l’extension du genou. Toutefois, toutes les déchirures ne produisent pas ce signe, d’où la nécessité d’examens complémentaires.
- Arthrotomie ou arthroscopie (visualisation directe) — Si la déchirure est fortement suspectée, la visualisation directe est la méthode la plus fiable pour confirmer le diagnostic. L’arthrotomie implique l’ouverture chirurgicale de l’articulation, tandis que l’arthroscopie est une technique peu invasive utilisant une petite caméra. L’arthroscopie offre plus de précision et une récupération plus rapide, ce qui en fait souvent l’option préférée.
- Imagerie avancée (IRM, scanner) — Les radiographies ne montrent pas les tissus mous, mais l’IRM peut détecter les lésions méniscales (meilleure résolution des tissus mous). L’IRM reste toutefois moins accessible en médecine vétérinaire. Les scanners (CT) avec contraste peuvent aider dans certains cas, mais sont généralement moins performants que l’IRM pour évaluer le ménisque.
Options de traitement d’une déchirure méniscale
Le traitement dépend de la sévérité de la lésion. Les cas bénins peuvent répondre à une prise en charge conservatrice, tandis que les déchirures importantes nécessitent souvent une intervention chirurgicale pour restaurer la fonction articulaire et soulager la douleur.
Prise en charge conservatrice (cas bénins)
Pour les lésions mineures, des soins non chirurgicaux peuvent être envisagés :
- Repos et restriction de l’activité — Repos strict en caisse ou promenades courtes en laisse pendant plusieurs semaines pour éviter l’aggravation.
- Physiothérapie et rééducation — Exercices doux, hydrothérapie et laser-thérapie pour améliorer la mobilité sans surcharger l’articulation.
- Gestion de la douleur (AINS, compléments articulaires) — Les anti-inflammatoires non stéroïdiens réduisent l’inflammation, et des suppléments comme la glucosamine et la chondroïtine soutiennent la santé cartilagineuse.
Cette approche convient aux petites déchirures stables et nécessite une surveillance rapprochée pour détecter une aggravation.
Traitement chirurgical (cas sévères)
Les déchirures importantes nécessitent souvent une chirurgie :
- Méniscectomie partielle — Ablation de la portion endommagée du ménisque pour éliminer la douleur et l’obstacle mécanique.
- Suture/réparation méniscale — Dans de rares cas, une réparation par suture est possible, mais les résultats sont moins prévisibles qu’en cas d’ablation partielle.
- Temps de récupération attendu — La plupart des chiens récupèrent en 8–12 semaines après la chirurgie, la rééducation accélérant la reprise de la mobilité et le renforcement musculaire.
Soins postopératoires et récupération
Une prise en charge postopératoire adaptée est cruciale pour une bonne récupération après une intervention sur le ménisque. Un plan de rééducation structuré réduit la douleur, restaure la mobilité et prévient de nouvelles lésions.
- Promenades contrôlées et restriction des mouvements — Éviter course, sauts et jeux brusques pendant plusieurs semaines. Courtes promenades en laisse sur surfaces planes pour favoriser la circulation sans surcharger le genou. Le repos en caisse ou dans un espace confiné est recommandé si le chien n’est pas surveillé.
- Exercices passifs d’amplitude articulaire — Quand le vétérinaire l’autorise, de légers mouvements de flexion/extension aident à maintenir la souplesse sans forcer. Effectuer lentement et sans douleur.
- Cryothérapie et thermothérapie — Glace (emballée dans une serviette) 10–15 minutes plusieurs fois par jour en phase aiguë pour réduire l’œdème ; plus tard, compresses chaudes pour améliorer la circulation et détendre les muscles raides.
- Retour progressif à l’activité — Vers 8–12 semaines, augmenter progressivement l’activité sous surveillance : hydrothérapie, montée lente d’escaliers, marche contrôlée. Un retour complet aux activités normales prend généralement 3–4 mois selon la guérison.
Signes à surveiller pendant la convalescence
Surveiller la récupération est essentiel pour détecter rapidement toute complication. Certains signes nécessitent une consultation vétérinaire.
- Gonflement qui dure plus de 5–7 jours — Une légère tuméfaction est normale, mais elle doit diminuer progressivement. Une persistance ou une aggravation peut signaler inflammation, infection ou épanchement articulaire.
- Douleur persistante malgré les médicaments — La douleur doit s’atténuer avec le temps ; si le chien gémit, lèche excessivement ou évite le mouvement, il peut y avoir une irritation persistante ou une complication.
- Incapacité à appuyer sur la patte après 5–7 jours — Si l’animal refuse totalement d’appuyer bien au-delà d’une semaine, envisager une réévaluation (lésion méniscale persistante, problème d’implant).
- Tout symptôme inhabituel — Écoulement à partir de l’incision, fièvre ou augmentation soudaine de la boiterie exigent une consultation immédiate.
Prévenir les déchirures méniscales après TPLO
La prévention repose sur une gestion post-opératoire prudente et des soins articulaires durables. Même si la TPLO stabilise le genou, il faut des précautions supplémentaires pour protéger le ménisque.
- Rééducation postopératoire adaptée — Un programme structuré (promenades contrôlées, étirements passifs, hydrothérapie) renforce l’articulation sans surcharger le ménisque. Éviter toute activité imprudente qui pourrait provoquer une lésion.
- Éviter les activités à fort impact trop tôt — Courir, sauter ou jouer brutalement pendant la convalescence augmente le risque. Réintroduire progressivement en suivant les recommandations vétérinaires.
- Contrôles vétérinaires réguliers — Des visites de suivi permettent d’évaluer la stabilité articulaire, le gonflement et la douleur ; en cas d’instabilité persistante, une prise en charge précoce évite des lésions méniscales.
- Compléments et thérapies de soutien — Glucosamine, chondroïtine et oméga-3 aident à maintenir la santé du cartilage et réduire l’inflammation. La physiothérapie, la laser-thérapie ou l’acupuncture peuvent améliorer la mobilité et réduire le risque de nouvelles atteintes.
Conclusion
La détection et le traitement précoces d’une déchirure méniscale après TPLO sont essentiels pour prévenir des lésions articulaires durables et assurer une bonne récupération. Reconnaître les signes — boiterie, douleur, difficulté à appuyer — permet une intervention rapide et diminue le risque de complications ultérieures.
Un plan de rééducation structuré est indispensable : promenades contrôlées, physiothérapie et réintroduction progressive de l’activité protègent l’articulation. Les soins post-opératoires appropriés, y compris la gestion de la douleur, la limitation des mouvements et les compléments articulaires, contribuent à la stabilité et au confort à long terme.
Si votre chien présente une douleur persistante, un gonflement ou une réticence à utiliser la patte au-delà de la période de guérison attendue, consultez un vétérinaire rapidement. Une lésion méniscale non prise en charge peut entraîner une souffrance chronique et une perte de mobilité. Avec une surveillance attentive, une rééducation adaptée et les conseils vétérinaires, de nombreux chiens retrouvent une fonction complète et une vie active sans douleur après une TPLO.
FAQ
Que se passe-t-il si un chien se déchire le ménisque après une TPLO ?
Une déchirure méniscale provoque douleur, boiterie et instabilité articulaire. Le genou peut émettre un cliquetis. Non traitée, la lésion favorise la douleur chronique et l’arthrose. Les options vont du repos et des anti-inflammatoires à la chirurgie (méniscectomie partielle).
Un ménisque déchiré peut-il guérir spontanément ?
Non : le ménisque a une vascularisation limitée et ne régénère pas bien. Les petites déchirures peuvent parfois être gérées sans chirurgie (repos, AINS), mais les déchirures significatives nécessitent souvent une intervention chirurgicale.
Comment savoir si une TPLO a été compromise ?
Signes d’échec : boiterie persistante, gonflement, refus d’appui, douleur croissante ou cliquetis articulaire. Radiographies, arthroscopie ou examen vétérinaire permettent de confirmer un problème.
Comment réparer une déchirure méniscale chez le chien ?
Selon la gravité : repos et traitement médical pour les petites lésions ; méniscectomie partielle (ablation de la portion endommagée) ou, plus rarement, réparation par suture pour les lésions réparables.
Pourquoi mon chien boîte-t-il 4 mois après une TPLO ?
La boiterie tardive peut provenir d’une déchirure méniscale, d’une consolidation incomplète, d’un problème d’implant ou d’arthrose. Un examen vétérinaire avec imagerie (radiographies, arthroscopie) aidera à identifier la cause.

Comment confiner votre chien après une chirurgie TPLO
Assurez la sécurité de votre chien après une chirurgie TPLO grâce à nos conseils de confinement : cage, barrières, espace sécurisé et soins quotidiens pour une guérison optimale
Pourquoi le confinement est essentiel après une chirurgie TPLO
Le confinement est l’un des éléments les plus importants de la récupération après une chirurgie TPLO. Après l’opération, le genou de votre chien est en cours de cicatrisation et reste instable. Limiter les mouvements protège la zone opérée et laisse au tissu osseux, aux tissus mous et à l’implant le temps de guérir correctement.
Sans confinement approprié, votre chien peut courir, sauter ou tourner brusquement la patte — des gestes qui peuvent causer de graves complications. Ces mouvements risquent de provoquer une nouvelle blessure, un échec de l’implant ou un retard de cicatrisation. Même une courte montée d’énergie dans les premières semaines peut compromettre la réparation chirurgicale.
Utilisez une cage, un parc ou une petite pièce avec sol antidérapant pour maintenir votre chien calme et en sécurité. En extérieur, utilisez toujours une laisse, même pour les sorties hygiéniques. Un confinement bien géré accélère la guérison, réduit la douleur et limite les complications.
Choisir le bon mode de confinement
Cage ou petite pièce
La cage est l’un des moyens les plus sûrs pour confiner un chien après une TPLO. Elle limite les mouvements tout en offrant un espace confortable et sécurisant. Elle empêche les sauts, courses ou torsions brusques qui pourraient nuire à la patte opérée.
La cage doit être assez grande pour que le chien se tienne debout, tourne et s’allonge, mais pas au point qu’il puisse y courir. Ajoutez une literie confortable et évitez les sols métalliques. Une petite pièce calme peut aussi convenir si la cage est trop restrictive.
Parc d’exercice (X-pen)
Un parc d’exercice est une alternative pour les chiens qui supportent mal la cage. Il offre un peu plus d’espace tout en limitant les mouvements dangereux. Utilisez-le uniquement si votre chien reste calme et ne saute pas sur les parois.
Placez le parc sur un sol antidérapant et fixez bien les panneaux. Évitez les jouets trop excitants. Installez-le dans un coin calme, à l’écart des distractions.
Barrières et portails
Les barrières (type barrières pour bébés) bloquent l’accès aux escaliers, couloirs ou pièces où le chien pourrait courir ou sauter. Elles sont utiles pour transformer une petite pièce en zone de repos.
Vérifiez qu’elles soient assez hautes et bien fixées pour éviter que le chien les renverse. Combinez-les à des portes fermées ou du mobilier pour créer un espace sécurisé, calme et équipé de literie.
Aménager un espace sûr et confortable
Sols antidérapants
Les sols lisses (carrelage, parquet) sont dangereux après une TPLO. Le chien peut glisser et se blesser ou endommager l’implant. Couvrez-les de tapis antidérapants, de tapis de yoga ou de coureurs caoutchoutés.
Ces surfaces offrent une meilleure adhérence et rassurent le chien lors de ses déplacements. Vérifiez que les tapis soient bien plats pour éviter toute chute.
Éliminer les dangers
Retirez tout objet risqué dans la zone de confinement : petits tapis glissants, meubles instables, coins tranchants, câbles électriques, jouets fragiles. Un espace dégagé réduit les risques d’accidents et permet au chien de se reposer sans stress.
Bloquer l’accès aux meubles et escaliers
Les sauts sur le canapé ou les escaliers sont à proscrire. Ces mouvements mettent trop de pression sur la patte en convalescence. Utilisez des barrières ou fermez les portes.
Si l’accès aux escaliers est inévitable (pour sortir dehors par exemple), utilisez une rampe ou portez votre chien avec un harnais de soutien.
Literie et confort
Installez une literie douce et épaisse pour protéger les articulations. Les matelas orthopédiques ou couvertures épaisses sont idéaux. Placez les gamelles d’eau et de nourriture à proximité pour éviter de longs déplacements.
Gardez l’espace propre : lavez régulièrement la literie et éliminez les saletés. L’hygiène contribue à la prévention des infections et au confort du chien.
Gérer la routine quotidienne en confinement
Laisse obligatoire hors confinement
En dehors de l’espace de repos, gardez toujours le chien en laisse, même à l’intérieur. Cela inclut les sorties hygiéniques ou les déplacements dans la maison. La laisse permet de contrôler sa vitesse et d’éviter les gestes brusques.
Respecter un planning régulier pour les besoins
Un horaire fixe pour les sorties réduit le stress et facilite la gestion. Sortez-le aux mêmes heures chaque jour et au même endroit. Évitez les promenades longues ou distrayantes. La régularité limite les accidents et maintient la sérénité.
Surveillance constante hors confinement
Le chien ne doit jamais être hors de son espace de repos sans surveillance. Même de courtes minutes sans contrôle peuvent entraîner des mouvements brusques et dangereux. Restez toujours à proximité avec la laisse.
Conseils finaux pour une récupération en douceur
L’état émotionnel du chien est aussi important que sa guérison physique. Maintenez un environnement calme, sans bruit excessif ni agitation. Si besoin, discutez avec votre vétérinaire de solutions apaisantes (suppléments, phéromones, etc.).
Au fil de la guérison, adaptez progressivement l’espace de confinement, par exemple en élargissant légèrement la zone ou en ajustant l’emplacement des gamelles. Faites toujours ces ajustements sous supervision vétérinaire.
La récupération prend du temps, mais avec patience, confinement adapté et soins attentifs, votre chien retrouvera progressivement une vie active et confortable.
FAQ
Comment garder un chien calme après une TPLO ?
Installez-le dans un espace calme et confiné, avec une literie confortable. Évitez les visiteurs et bruits forts. Des jouets calmes ou des puzzles alimentaires peuvent aider. Consultez votre vétérinaire pour des solutions anti-stress si nécessaire.
Puis-je laisser mon chien seul après une TPLO ?
Oui, mais seulement s’il est confiné en cage ou en parc sécurisé. Évitez de le laisser seul longtemps, surtout la première semaine.
Peut-il marcher librement dans la maison ?
Non, la liberté dans la maison est trop risquée. Déplacements uniquement en laisse pour les sorties toilettes.
Combien de temps dure la douleur après une TPLO ?
La douleur dure en moyenne 7 à 10 jours, bien contrôlée par les médicaments prescrits. Si elle persiste ou s’aggrave, consultez votre vétérinaire.
